« Matriarcat : enquête sur un mythe » : un article dans L'Histoire

Le magazine L'Histoire, dans son n°101 « collection » consacré à la Préhistoire, reprend mon article sur le mythe du matriarcat, déjà publié en avril dernier. Et dans le même numéro, de nombreuses autres contributions de spécialistes (et non des moindres, comme on peut le vérifier en consultant le sommaire) à recommander chaudement !


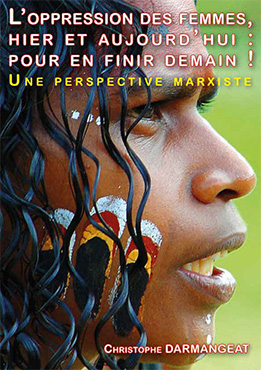

Bonjour, Christophe.
RépondreSupprimerJ'ai lu dans L'Histoire ton article, dont je te remercie, ainsi que les autres articles de cette revue : N Teyssandier, E Guy, JL Le Quellec et al. Très intéressants ! Mais c'est d'un autre sujet que je voudrais parler, à propos de cette revue. Il est toujours amusant (ou agaçant) de voir à quel point le roman est malmené dans les publications à prétention scientifique. Méprisé serait sans doute un mot plus juste : ce qu'on méprise vaut-il la peine d'être observé sérieusement ? Je viens d'écrire à L'Histoire le petit mot suivant :
Madame, Monsieur,
dans le numéro 101 hors-série de L'Histoire, qui traite de la préhistoire, la page 67 est consacrée au roman de J.-H. Rosny Aîné, La Guerre du feu. Si on omet les images, c'est donc moins d'une demi-page (sur 130 pour l'ensemble du magazine) qui est consacrée à ce roman fondateur de l'imaginaire de la Préhistoire dans l'espace francophone, et au-delà. Sur cette petite demi-page, et en dépit de son admiration pour Rosny, Claude Aziza réussit pourtant à accumuler un nombre impressionnant d'erreurs grossières et d'approximations.
Quelques exemples : non, la longue nouvelle Les Xipéhuz ne se déroule pas dans "le futur" ; non, le "merveilleux scientifique" n'était pas en 1887 "un nouveau genre romanesque" inventé par Rosny ; non, Helgvor du Fleuve Bleu n'est pas le troisième tome d'une trilogie ; non, la parution de La Guerre du feu dans la revue Je sais tout n'était pas partielle, etc.
J.-H. Rosny Aîné est un romancier fascinant, étudié depuis longtemps. Les préhistoriens ont écrit au sujet de La Guerre du feu quelques remarques très intéressantes, et beaucoup d'âneries. Qui s'intéresse sérieusement à cet auteur peut consulter le blog de Fabrice Mundzik, ou les travaux d'Eric Lysoe, de Mélanie Bulliard, Pierre Citti et beaucoup d'autres... ou les miens.
Bien à vous.
Marc Guillaumie.
Merci de cette remarque. C'est un sujet sur lequel je me déclare totalement incompétent...
SupprimerBonjour, je pense que vous confondez la gynocratie avec le matriarcat
RépondreSupprimerJe l'avoue bien volontiers. Toutefois, à moins d'inventer des significations ou des étymologies pour jeter de la confusion dans les choses claires, les deux termes signifient à peu près la même chose – exactement comme en, sens inverse, phallocratie et patriarcat.
SupprimerIl me semble que
SupprimerMatriarcat : les femmes/hommes sont libres de leurs sexualités, les femmes élèvent avec leurs frères les fruits de leurs aventures. Pas de couple/mariage/paternité
Et que c'est une société fondée sur la filiation maternelle. A ne pas confondre avec la gynocratie, erreur et abus de langage datant de Bachofen. Le matriarcat =/= société à direction féminine.
J'ai trouvé cette définition "Le matriarcat est un modèle où les femmes élèvent avec leurs frères les enfants qu'elles ont obtenues par le biais d'union libres avec d'autres hommes, il n'y a pas de mariage ou de couple, ce qui sous entend une grande liberté sexuelle. Du latin mater, la mère et non la femme, le matriarcat est donc « l’ordre fondé sur la maternité », un modèle de société fondé sur la filiation maternelle. C’est pourquoi il ne faut pas le confondre avec un autre concept, celui de la gynocratie (ou gynarchie). Du grec gunê, « femme » et cratos, le pouvoir, gynocratie qui signifie « pouvoir aux femmes », et qui par conséquent à plus à voir avec le pouvoir politique que l’organisation familiale. Une gynocratie ou gynécocratie est un régime politique dans lequel le pouvoir est exercé par des femmes"
C'est bien ce que je disais. On peut imaginer de donner aux mots un sens qu'ils n'ont pas, sortir des définitions nouvelles de son chapeau (ou de celui de Goettner-Abendroth) et choisir d'appeler « dragon » tout quadrupède à écailles, ce qui nous permettra d'affirmer triomphalement que non seulement les dragons existent, mais qu'on en trouve dans à peu près n'importe quel espace vert. En quoi cela apporte-t-il autre chose que de la confusion ? Et si le matriarcat n'a rien à voir avec la domination des femmes, j'imagine donc qu'en toute logique le patriarcat n'a rien à voir avec la domination des hommes ?
SupprimerC'est pour cela que je vous ai redirigé vers l'article de contrepoints, l'auteur s'exprime mieux que moi. Je pense que vous y verrez bcp de choses intéressantes
SupprimerD'ailleurs je vous renvoi vers cet article qui me semble éclairant. Je ne sais pas quelles critiques vous feriez de cette vision du patriarcat ?
RépondreSupprimerhttps://contrepoints-archives.org/faire-contre-loppression-femmes/
Pour le dire charitablement, cet article est tout simplement lamentable. Il construit son raisonnement en faisant du cherry-picking parmi les faits ethnologiques, et en passant sous silence tous ceux qui contredisent sa thèse. Et au passage, j'ai recherché qui était l'auteur via Google ; il semble qu'il soit aussi sérieux en ce qui concerne ses titres et compétences qu'avec les données scientifiques.
SupprimerJe peux comprendre votre point de vue, mais pourriez-vous vous rapidement m'expliquer le problème dans ce schéma des mécanisme patriarcaux qui se base sur sa première raison d'être : assurer à un homme qu'il est le père des enfants de la compagne avec laquelle il vit - et les conséquences diverses que cela engendre ?
SupprimerL'idée que la première raison d'être de la domination masculine serait la nécessité d'assurer au mari la certitude de sa paternité est parfaitement ethnocentrique. Il existe de très nombreux exemples ethnologiques (dont l'Australie et les Inuits) où la domination masculine est revendiquée et organisée, sans que les maris soient moindrement préoccupés de leur paternité biologique - ils prêtent volontiers leur épouse dans un certain nombre de circonstances.
SupprimerSi le sujet vous intéresse, pourquoi ne pas l'aborder via un livre sérieux (le mien, par exemple) ?
Au passage, je suis allé jeter un œil sur l'auteur de l'article et le site qui l'héberge, c'est tout de même édifiant. Le seul Gabriel Delauney que connaît internet est un jeune animateur périscolaire. On en déduira donc que cet "Historien, romancier et dramaturge" écrit sous pseudonyme, ce qui nous empêchera donc d'avoir la moindre idée de ses qualifications (mais il est, dixit « admirateur de Bastiat », ce qui prouve au moins qu'il est aussi peu pertinent en économie qu'en anthropologie sociale). Quant à Contrepoints, je lis qu'il s'agit de l'organe de l'IREF, un think-thank libéral flirtant avec l'extrême-droite, spécialisé dans les questions fiscales.
SupprimerBref, c'est à peu près comme si on voulait s'éclairer sur une question médicale en lisant la revue des Témoins de Jéhovah (NB : ce n'est pas parce qu'elle s'intitule « Santé mentale » qu'elle s'appuie sur les connaissances scientifiques en psychiatrie).