Note de lecture : « La marche de l'histoire », de V. Citot et J.-F. Dortier

La première chose à relever dans cet ouvrage récemment paru aux éditions Sciences humaines est l’originalité de sa forme. Il s'agit d’un livre d’entretiens, mais où les deux protagonistes sont placés sur un pied d’égalité. Il n’y a pas, comme le plus souvent, un interviewer et un interviewé, l’un qui poserait des questions avec une candeur plus ou moins feinte, et l’autre qui y répondrait. Le parti-pris du texte est de mettre en scène un dialogue entre deux participants qui, s’ils partagent les mêmes interrogations, divergent parfois sur les réponses à y apporter. Précisons que ce dialogue en est vraiment un : les auteurs ne se sont pas contentés de lister des questions, puis d’y répondre chacun de leur côté. Le lecteur se trouve plongé dans une véritable discussion, où les arguments font écho les uns aux autres, et où chaque interlocuteur écoute – à défaut d’approuver – ce que l’autre énonce. Ce choix contribue bien évidemment à rendre la lecture de l’échange particulièrement plaisante.
Le second aspect qui retient l'attention est l’ambition du propos. Celui-ci traite de grandes questions : la marche des sociétés humaines, qu’il s'agisse de leur technique, de leur organisation ou de leurs produits intellectuels, suit-elle une logique, et laquelle ? Quel est le poids des idées dans le changement social ? Quels en sont les autres facteurs ? Comment s’articule le caractère général de l’évolution sociale (en particulier, les convergences évolutives observées), avec la grande variabilité des trajectoires locales ? Les cultures s’inscrivent-elles dans une histoire cyclique ? Peut-on parler de « progrès » ? Comment expliquer l’émergence de l'État ? Etc. Non seulement ces questions, trop souvent évitées par la littérature savante, sont ici abordées de front, mais elles le sont de la meilleure des manières, avec un constant souci de clarté et sans la moindre volonté de noyer le poisson dans des considérations fumeuses ou un vocabulaire jargonneux.
Ce constat n’a rien pour surprendre, quand on connaît le parcours des deux auteurs. Jean-François Dortier est le fondateur du groupe Sciences Humaines, qui s'efforce depuis des années de proposer une vulgarisation de qualité des débats qui touchent à l'ensemble de ces sujets. Quant à Vincent Citot, il fait partie de ces trop rares philosophes à considérer qu’il est essentiel de réfléchir à partir de données tangibles, et de le faire de manière à être compris de ses contemporains – en d’autres termes, ses écrits illustrent l’adage selon lequel la clarté n’est pas synonyme de superficialité, et l’obscurité de profondeur.
Tout cela produit un ouvrage très stimulant et hautement recommandable, dans la mesure où il réussit à être tout à la fois érudit et accessible. On peut dire de lui qu’il aborde l'ensemble des questions que doit se poser tout scientifique (et plus généralement, tout individu) désireux de comprendre le devenir des sociétés humaines. Loin d’être problématiques, les points de divergence – auxquels on pourrait ajouter celles que le lecteur pourra lui-même parfois ressentir – appellent au contraire à pousser la réflexion, et de très nombreuses références permettront de le faire en prenant connaissance des travaux des spécialistes des différentes disciplines convoquées.
La marche de l’histoire.
Évolution des sociétés, cultures et idées, des clans préhistoriques au 21e siècle.
Dialogue entre Vincent Citot et Jean-François Dortier
Sciences Humaines, collection Essais
230 pages. Version papier 18 €, électronique 15 €
Pour la bonne bouche et pour finir, quelques morceaux choisis (j’ai volontairement omis de préciser lequel des deux auteurs avait tenu chacun d’eux, cela fait partie du teasing) :
J’ai toujours refusé que la philosophie soit une spécialité d’initiés ; et, contre beaucoup de mes collègues, j’ai systématiquement défendu les pratiques et usages non professionnels de ma discipline. Non par charité, mais parce qu’il arrive que les non-spécialistes posent des questions plus frontales, plus authentiques et finalement plus philosophiques. Tandis que, trop souvent, les philosophes professionnels se perdent dans des considérations techniques, dans un jargon convenu et des références révérencieuses à « la tradition ». (14)
Le travail de l’historien ne consiste pas à restituer le passé selon la vision du monde en vigueur dans ce passé même. Sinon, il faudrait être animiste pour parler des animistes, aztèque pour parler des Aztèques, etc. (20)
Il me semble aussi faux de dire que l’infrastructure détermine de façon univoque le contenu des idées que de prétendre que ces idées flottent en l’air sans lien avec les conditions socioéconomiques. On ne peut expliquer la doctrine de Platon simplement en faisant une analyse sociologique du milieu où il a vécu. Mais le platonisme comme geste philosophique, orientation intellectuelle et pôle d’attraction des esprits de la première moitié du 4e siècle av. J.-C. s’explique largement par le contexte socio-historique. (28)
Pourquoi la philosophie est apparue en Grèce, en Chine, en Inde puis en Islam, et pas en Mésopotamie ou en Égypte (autant qu’on sache) ? Parce que davantage qu’en Mésopotamie et en Égypte, la Grèce était divisée en cités concurrentes, la Chine en Royaumes combattants, l’Inde gangétique du 6e siècle avant notre ère en unités politiques et en sectes dissidentes, et l’Islam en factions ou écoles rivales. Ces unités (politiques, économiques ou religieuses) étaient en concurrence, y compris sur le plan intellectuel. Les clercs, les conseillers du prince ou les penseurs en général qui les représentaient ou qui voyageaient d’une cité à l’autre devaient hisser leur niveau de raisonnement pour se maintenir à l’avant-garde. (30)
Le pouvoir des intellectuels et des maîtres penseurs ne leur vient pas des idées qu’ils défendent, mais de leur position sociale. Ce ne sont pas les idées qui ont du pouvoir (la raison est bien faible, disait Pascal ; sa force sociale est négligeable, renchérit Le Bon), mais ceux qui les portent (qu’il s’agisse du « peuple » ou des « élites »). (69)
En toute rigueur, il faudrait distinguer deux niveaux de complexité : la complexité sociale (diversification plus ou moins prononcée des rapports sociaux) et la complexité culturelle (diversification plus ou moins prononcée des produits de ces rapports). Le degré de complexité social se mesure par le niveau de division du travail (diversité des métiers) et d’organisation hiérarchique (diversité des statuts – cela comprend les rapports de parenté, mais aussi l’ensemble des formes d’autorités politiques, administratives, religieuses, etc.). Le degré de complexité culturelle se mesure, non par la nature des rapports sociaux, mais par leurs résultats : diversité des institutions, des produits matériels, des services, des réalisations artistiques et intellectuelles. (82)
Je crois en effet qu’il n’y a pas à choisir entre histoire cyclique et histoire linéaire, car les deux conceptions sont vraies à des niveaux différents. Si l’on se concentre sur l’évolution d’une civilisation particulière, on voit un cycle ; mais dès que l’on prend un certain recul, on a affaire à des dynamiques cumulatives, les effets de cliquet et des diffusions massives, qui brouillent la vision cyclique. (145)
L’un des problèmes majeurs de l’histoire universelle (et de sa périodisation) est, comme tu le soulignes, le fait que l’humanité ne marche pas au même rythme. Les anti-évolutionnistes ajoutent que toutes les sociétés ne marchent même pas dans le même sens. Enfin, toutes les sociétés marchent-elles ? La critique de l’évolutionnisme est décisive pour les illusions qu’elle déconstruit : linéarité d’une histoire-progrès, repérage de grandes étapes nécessaires sur ce chemin unique, européocentrisme. Mais aboutir à la conclusion que l’histoire humaine ne connaît aucune orientation majeure, aucune ligne de force et qu’elle n’obéit à aucune loi, c’est à la fois un présupposé a-scientifique et une erreur dans l’analyse des faits. Car même si toutes les sociétés ne se transforment pas au même rythme, on repère dans l’histoire des phénomènes de convergence et une synchronicité relative. (157)


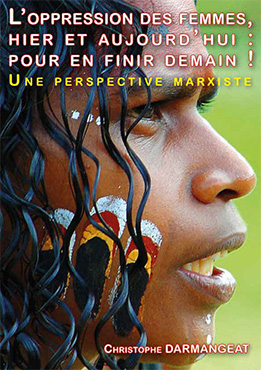

J'ai commencé la lecture de ton compte-rendu avec quelques gouttes de sueur/frayeur sur le front, car je sais que tu n'as pas la langue de bois, que tu ne te prives pas de dire ce qu'il faut dire, même quand ce n'est pas agréable, et surtout que les critiques que tu formules sont toujours justes (enfin, il me semble). La lecture terminée, me voilà tout détendu et très reconnaissant. Merci pour ton oeil généreux!
RépondreSupprimerPas de quoi, j'ai sincèrement bien aimé le livre (même si je pense qu'on pourrait rediscuter de tout cela point par point, avec éventuellement certaines divergences et que par ailleurs, nous avons probablement quelques solides désaccords politiques, mais c'est en large partie une autre histoire !). En tout cas, ce type de texte est vraiment le bienvenu, et j'espère qu'il aura un écho. Y a-t-il eu d'autres recensions ?
SupprimerBonjour, je viens de terminer ce livre, notamment sur votre recommandation et même s'il a été très intéressant notamment en offrant une synthèse accessible des grandes questions et théories sur l'évolution des sociétés humaines, j'ai été très étonné de la place offerte à la psychologie évolutionniste et à la génétique notamment concernant l'intelligence. Avez-vous un avis sur la question ? Ne sont-elles pas des approches plus que contestable en sciences sociales ?
RépondreSupprimerD’ailleurs M. Citot semble énoncer une fausse information concernant un consensus scientifique en psychologie cognitive, neuroscience et génétique, qui voudrait que 50% de nos aptitudes cognitives soient héréditaires (p.138). Pour cela il cite en référence, parmi d'autre, Robert Plomin (auteur qui défend l'idée que l'éducation compte peu dans la réussite scolaire aux vues du poids de la génétique). Cette affirmation de consensus m'étonnant fortement, je fais une recherche google et en 3 clics je tombe sur un article de l'express qui interview la généticienne Françoise Clerget-Darpoux du 20 avril 2023 qui critique explicitement les travaux de Plomin, je cite : "comme de nombreux généticiens - et contrairement à Robert Plomin ou à Kathryn Paige Harden -, je ne pense pas qu'il soit possible, dans l'espèce de mesurer la contribution respective de ce qui est du à la génétique et de ce qui est dû à l'environnement".
Dans une tribune du monde de 2018 intitulée "Halte aux « fake news » génétiques" et signé par plusieurs chercheurs et chercheuses on pouvait lire ceci : "Ces invocations de pourcentages génétiques sont un usage dévoyé de la notion scientifique d’héritabilité… D’une part, l’héritabilité dépend à la fois des variations génétiques et des variations environnementales présentes dans la population étudiée. En particulier, elle peut varier de 0 % à 100 % selon les conditions d’environnement. D’autre part, le fait que la variabilité génétique puisse rendre compte de x% de la variabilité d’un trait ne signifie pas qu’elle en est la cause biologique". Et la tribune se terminait ainsi : "En fait, hormis les effets délétères de certaines anomalies génétiques, la recherche n'a pas pu à ce jour identifier chez l'humain de variantes génétiques ayant indubitablement pour effet de créer, via une chaîne de causalité strictement biologique, des différences cérébrales se traduisant par des différences cognitives ou comportementales. Ces usages trompeurs de « quantifications génétiques » sont graves, s'agissant de sujets à forts enjeux politiques. Lorsqu'ils sont le fait de scientifiques prétendant exprimer l'état des savoirs en génétique ou en neurosciences, il s'agit à nos yeux d'un manquement caractérisé à l'éthique scientifique".
Du coup y a-t-il réellement un consensus ou est-ce une fausse information ? Si c’est une fausse information la chose semble grave aux vues des conséquences de ce postulat. D’ailleurs tout au long de l’ouvrage M. Citot mobilise cette idée pour expliquer en partie l’apparition de la révolution industrielle en Europe (p.167), recyclé la théorie de l’hiver froid (théorie raciste de Richard Lynn), expliqué l’émergence du capitalisme (p.169) bref selon lui « une civilisation se développe […] quand les mieux dotés font plus d’enfant que les autres » (p.138-139) avec une référence étrange au film Idiocracy sous entendant que le scénario du film serait plausible scientifiquement. Ces affirmations ouvrent bien sûr grand la porte à l’eugénisme le plus abjecte mais M. Citot n’y voit aucun souci puisqu’il nous dit « ma question n’est pas de savoir si une idée est dangereuse mais si elle est vraie ». Et je serais bien évidemment d’accord avec cette phrase mais encore faut-il que l’idée en question soit solidement soutenue par la communauté scientifique ce qui n’est visiblement pas le cas.
(suite du commentaire) On voit d'ailleurs jusqu'où mène ce postulat de départ pour M. Citot qui va jusqu'à citer explicitement Laurent Alexandre (eugéniste assumé), personnage plus que contesté dans le domaine de la science, le présentant visiblement comme quelqu'un de compétent en la matière voir comme un lanceur d'alerte sur les risques de creusement des inégalités en matière génétiques et cognitives. Or il faudrait déjà que les inégalités d'intelligence liées à la génétique soit attesté pour qu'elles puissent se creusées ce qui n'est visiblement pas le cas. Un billet de blog du monde en 2013 intitulé "« La guerre des cerveaux », controverses et interrogations" signé par de nombreux chercheurs et chercheuses ciblant explicitement Laurent Alexandre commençait ainsi : "Tout d'abord, Laurent Alexandre relaie une erreur scientifique quand il parle de « la part génétique de l’intelligence », qu’il évalue à « 50 % ». Or évoquer un tel pourcentage est une erreur grave, car il se fonde sur une méthode statistique qui se contente d’additionner une « part génétique » et une « part environnementale » en négligeant que les gênes et l'environnement sont simultanément impliqués dans tout trait biologique : ces variables sont en interaction, elles ne sont pas indépendantes." Cet extrait en plus de critiquer Laurent Alexandre confirme visiblement également le fait qu'il n'existe aucun consensus concernant ce chiffre de 50% de la part génétique des capacités cognitives.
SupprimerDésolé de la longueur de ce commentaire mais du coup j’aurai voulu connaitre votre avis sur la question en tant qu’anthropologue social car je pensais que les sciences sociales avait mis à l’écart depuis longtemps tous ce qui se rapprochait de près à la sociobiologie et donc à la biologisation du social. D’ailleurs la psychologie évolutionniste est une des rare discipline (si je ne dis pas de bêtise) mise explicitement de côté par Bernard Lahire, pour ces aspects controversés, dans son ouvrage « les structures fondamentales des sociétés humaines » qui cherche à sociologiser le biologique plutôt que l’inverse. J’ai été également étonner que M. Dortier ne rebondisse pas sur ces questions au cours de l’ouvrage pour les critiquer ou les nuancer. Le QI est par exemple mobilisé sans être critiqué sans parler de la notion même d’intelligence.
Je tiens à signaler que je n’ai pas du tout la légitimité, ni les connaissances ni le capital culturel nécessaire pour émettre une réelle critique je m’excuse donc par avance si mes critiques sont biaisés, si j’ai mal compris ou déformé les propos de M. Citot. Le but de ce commentaire est justement de savoir si mes critiques sont fondées ou si je suis complétement à côté de la plaque (ce dont je m’excuse par avance dans ce cas) du fait de mon ignorance concernant la génétique et la psychologie évolutionniste.
Bien cordialement.
https://www.lexpress.fr/sciences-sante/robert-plomin-se-trompe-en-disant-que-leducation-compte-peu-dans-la-reussite-scolaire-47Z4G6LH7FCEZETPBRQ4DOFPZ4/?cmp_redirect=true
https://www.lemonde.fr/sciences/article/2018/04/25/halte-aux-fake-news-genetiques_5290360_1650684.html
https://www.lemonde.fr/le-monde/article/2013/03/26/la-guerre-des-cerveaux-controverses-et-interrogations_5995843_4586753.html
Bonjour Steve.
RépondreSupprimerVotre commentaire ne s’adresse pas à moi, mais peut-être puis-je tout de même essayer d’éclaircir un ou deux points.
Tout d’abord, vous avez parfaitement raison à propos des affirmations suivantes :
--« l’héritabilité dépend à la fois des variations génétiques et des variations environnementales »
--« elle peut varier de 0 % à 100 % selon les conditions d’environnement » [je dirais plutôt de 5% à 95%, mais on ne va pas chipoter]
--« le fait que la variabilité génétique puisse rendre compte de x% de la variabilité d’un trait ne signifie pas qu’elle en est la cause biologique »
--« la recherche n'a pas pu à ce jour identifier chez l'humain de variantes génétiques ayant indubitablement pour effet de créer, via une chaîne de causalité strictement biologique, des différences cérébrales se traduisant par des différences cognitives ou comportementales ».
--« les gênes et l'environnement sont simultanément impliqués dans tout trait biologique : ces variables sont en interaction, elles ne sont pas indépendantes ».
--Le QI est une mesure imparfaite de l’intelligence
--L’intelligence est une notion qui mérite d’être discutée.
Tout cela est bien connu et même régulièrement réaffirmé par les chercheurs en psychologie évolutionnaire et des spécialistes de l’héritabilité des traits psychologiques. Et cela ne remet nullement en cause l’idée que la variabilité de l’intelligence phénotypique s’explique à x% par des mécanismes héréditaires. Ce pourcentage varie selon les traits, évidemment, mais aussi selon les âges.
Bref, l’alternative n’est pas : causalité biologique linéaire OU BIEN pas d’héritabilité.
Nombre de chercheurs dénoncent (à juste titre) certaines interprétations qui sont faites des données sur l’héritabilité et les abus ou les exagérations. Mais le principe de l’héritabilité partielle de l’intelligence n’est pas en cause.
Que l’environnement contribue énormément à l’intelligence est une évidence, et je ne connais aucun chercheur en psychologie évolutionnaire qui le conteste, (mêmes ceux qui sont dénoncés comme racistes).
Il y a deux grandes méthodes pour évaluer la part d’héritabilité de l’intelligence (ou plutôt, des variations constatées d’intelligence phénotypique dans une population donnée) : la « méthode des jumeaux » et les « GWAS ». Je ne peux développer ici, mais il ne s’agit pas là de méthode « au doigt mouillé ».
Il me semble que je cite Alexandre non comme une autorité scientifique, mais plutôt comme un lanceur d’alerte sur les conséquences des inégalités cognitives. De fait, il ne fait lui-même que relayer des études savantes et il n’est pas lui-même publié dans des revues internationales sur ces questions d’héritabilité.
Vous avez raison aussi sur le fait que les sciences sociales voient d’un très mauvais œil, en général, la psychologie évolutionnaire et toute tentative de biologiser le social. Et en effet, même Lahire se tient à distance.
Comme je ne puis ici développer davantage, sachez simplement que, à titre personnel, je n’avais aucun a priori sur la question. Au plutôt, j’avais un a priori « tout culturel », hérité de ma formation. C’est en creusant la question que je me suis rendu compte que ce paradigme ne tenait pas la route.
Comme vous le rappelez, « le vrai » m’importe plus que tout dans cette affaire. Quel que soit ce « vrai », on ne pourra jamais en déduire du racisme moralo-politique, car la question des normes est un autre terrain.
Je note que la lutte contre le racisme sait aussi utiliser les arguments héréditaristes (par ex. Kathryn Paige Harden).
J’espère que cette réponse apporte quelques éléments intéressants, même si elle ne pouvait être que succincte.
Bonjour je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mon commentaire. Je m'en excuse mais votre réponse ne m'éclaire pas beaucoup plus. Tout d'abord car vous ne répondez pas à ma principale interrogation qui concernait l'affirmation d'un consensus scientifique en psychologie cognitive, neuroscience et génétique, qui voudrait que 50% de nos aptitudes cognitives soient héréditaires (p.138). En validant les critiques tirées des différents articles cités dans mon commentaire reconnaissez-vous donc que ce consensus n'existe pas ? (Si vos propos avaient été "certains chercheurs affirment que 50% de nos aptitudes cognitives sont héréditaires" cela ne m'aurait pas interpellé de la même manière et je n'aurais pas rédigé mon commentaire précédent).
SupprimerJe n'ai pas de mal à accepter l’idée que la variabilité de l’intelligence phénotypique s’explique à x% par des mécanismes héréditaires mais affirmer un consensus quantifiant ce pourcentage à 50% est une autre histoire n'êtes-vous pas d'accord ? De plus, pour quantifier cette part génétique il faut partir du postulat qu'il est possible de séparer génétique et environnement, ce qui selon les critiques n'est pas possible puisque les deux sont imbriqués, donc est-il sérieux de donner des chiffres dans ce cas-là ? Car les critiques si je les ai bien comprise n'oppose pas le tout biologique au tout culturel (qu'elle rejette aussi) mais affirme l'imbrication des deux rendant impossible une quantification.
Concernant les méthodes (« méthode des jumeaux » et les « GWAS ») même si elles ne relèvent pas du doigts mouillées, et je n'en doute pas une seconde, elles sont fortement critiquées et comportent de nombreux biais (Françoise Clerget-Darpoux les abordent dans l'article cité précédemment).
Je répète que je n'ai ni les compétences ni les connaissances pour avoir une critique personnelle sur le sujet j'essaie juste d'y voir plus claire à partir des positions des chercheurs spécialistes et j'ai tendance à ma fier plus facilement aux spécialistes qui mettent en garde contre les interprétations, les instrumentalisations ou les exagérations faites à partir des recherches de leurs disciplines. Certains chercheurs en neurosciences et en génétiques ont l'honnêteté intellectuelle de rappeler avant tout que leurs disciplines sont très récente et que l'ignorance autour du cerveau et de la génétique est encore conséquente même si bien sûr des avancées considérables ont visiblement été faite.
Concernant Kathryn Paige Harden (merci pour le partage) je viens de lire un article critique de Kevin Bird intitulé "La Loterie génétique est un échec pour la génétique et la politique" qui reprend les mêmes critiques faites par les articles précédemment cités envers la génétique comportementale et confirment encore mes critiques et mes réserves concernant cette discipline.
Pour finir ma critique portait également et surtout sur la réception des lecteurs et lectrices concernant ce consensus que vous affirmez et ces conséquences éthiques et politiques. Dans l'article précédemment cité, Kevin Bird écrit : "Une dernière remarque concerne la manière dont ces recherches sont interprétées par la population, si cette dernière s'en saisissait plus largement. Les chercheurs se sont rendu compte, à l'aide d'expérimentations en ligne, que le simple fait de classer les individus en fonction de leurs scores polygéniques corrélés au niveau d'études conduisant à des stigmatisations ou des prophétie auto-réalisatrices. [...] Ces résultats suggèrent non seulement que les données génétiques mènent à des raisonnements essentialistes qui peuvent renforcer des inégalités existantes, mais ce genre de relations peut également ajouter encore plus de facteurs confondants, compliquant ainsi l'utilisation des données génétiques dans le cadre des questions sociales". Bref il me semble donc que les affirmations de la génétiques comportementales en plus d'être contestable et visiblement hasardeuse engendre une forme de naturalisation des inégalités dangereuses tant scientifiquement que politiquement. Et donc dans votre ouvrage "La marche de l'histoire" ce qui me questionne d'autant plus c'est la prédominance que vous accordez à ces thèses pour expliquer l'évolution sociale et plus particulièrement le déclin des civilisations.
Supprimerhttps://aoc.media/analyse/2023/05/30/la-loterie-genetique-est-un-echec-pour-la-genetique-et-la-politique/