Faim de justice

Pour commencer, il me faut signaler que pour la matière de ce billet, je suis entièrement redevable à Arthur Gicqueau, doctorant en archéologie, avec qui j’ai eu le plaisir d’organiser le colloque « Le corps de mon ennemi » (avril 2024), et qui a récemment porté à mon attention un joli lièvre à propos d’anthropophagie.
Si l’on suit la belle synthèse proposée par Bruno Boulestin et Dominique Henry-Gambier dans leur livre sur les restes humains de la grotte du Placard, il existe trois grands types d’anthropophagie. Le premier se rapporte à des situations de crises, dont l’exemple le plus célèbre est celui du radeau de la Méduse. En pareil cas, le cannibalisme est une pratique exceptionnelle, qui déroge au cadre culturel normal. Restent donc les actes de cannibalisme qui intervennent dans un contexte suffisamment régulier pour être socialement approuvé, si ce n’est encouragé ou prescrit. Ils se divisent à leur tour en deux grandes catégories, l’endo-cannibalisme (on mange les siens) et l’exo-cannibalisme (on mange les autres). Selon les auteurs :
[Cette dichotomie] va bien au-delà de la simple relation entre mangeur et mangé, car [elle] définit en même temps le contexte de survenue de l’acte, à tel point que l’on peut établir une équivalence pratiquement parfaite entre d’une part l’endocannibalisme et un cannibalisme funéraire, d’autre part l’exocannibalisme et un cannibalisme « guerrier ». En effet, dans l’endocannibalisme on consomme ses propres morts dans le cadre de rituels funéraires, principalement pour les honorer (d’autres motivations sont avancées, mais celle-ci est universelle), tandis que dans l’exocannibalisme ce sont les adversaires ou ennemis que l’on mange, pour des raisons alléguées qui peuvent varier, mais fondamentalement pour les anéantir.
Les éléments repérés par Arthur (et qui, bien qu’ils concernent avant tout l’Australie, m’avaient échappé) viennent nuancer l’équivalence ici établie entre endocannibalisme et pratiques funéraires. En clair, il existe au moins une sorte (et possiblement deux) d’endo-cannibalisme qui ne s’inscrit pas dans ce cadre.
Les données rassemblées dans un court mais percutant article d’E. G. Heap (« Some Notes on Cannibalism Among Queensland Aborigines, 1824-1900 », Queensland Heritage, 1967) suggèrent en effet la présence relativement répandue en Australie précoloniale d’un cannibalisme judiciaire, qui s’ajoutait à la peine de mort pour des fautes particulièrement graves. Trois sources font état de telles pratiques. Alfred Howitt, pour commencer, qui rapporte un témoignage émanant des Mukjarawaint (ou Jardwadjali) du sud-est, concernant le sort de celui qui aurait commis un inceste – rappelons que l’inceste n’est pas la pédophilie, et qu’en Australie, il désigne le fait d’avoir des rapports sexuel avec un.e partenaire de la même « section », c’est-à-dire du même groupe de parenté que le sien :
Lorsque un homme s’était emparé d’une femme qui était du même Yauerin [section] que le sien, les poursuivants, s’ils l’attrapaient, le tuaient, et à l’exception de la chair des cuisses et des bras, qui étaient rôtis et mangés, ils découpaient le corps en petits morceaux, qu’ils abandonnaient sur le sol. La chair était mangée par les membres de son totem, y compris par ses frères. On dit que cette coutume était également celle des Jupagalk. (Native Tribes of Southeast Australia, p. 247)
Deux autres sources, bien que plus laconiques, sont tout aussi explicites. La première est le livre de Daisy Bates, The passing of the Aborigines. Elle évoque les femmes des groupes d’Australie méridionale jugées trop « débauchées » (wanton), qui « dans tous les campements, peuvent être légalement tuées et mangées ». Roth rapporte une information similaire pour le Queensland, à l’autre extrémité de l’île, dans la région du fleuve Tully (North Queensland Ethnography, Bulletin n°3, 1901, p. 30)
Au passage, les écrits de Daisy Bates (de même que quelques autres) soulèvent une autre possibilité : celle d’un cannibalisme qui viserait spécifiquement les nouveaux-nés et les enfants en bas âge. Elle écrit par exemple :
Le cannibalisme infantile était très répandu parmi ces peuples du centre-ouest, comme c’est le cas à l’ouest de la frontière, en Australie centrale. Dans un groupe, à l’est des fleuves Murchison et Gascoyne, toutes les femmes qui avaient eu un enfant le tuaient et le mangeaient, le partageant avec leurs sœurs qui, à leur tour, tuaient leurs enfants à la naissance et rendaient le cadeau alimentaire, de sorte que le groupe n’avait pas conservé un seul enfant vivant pendant plusieurs années. Lorsque la terrible envie de manger de la chair de bébé submergeait la mère avant ou pendant l’accouchement, l’enfant était tué et cuit, quel que soit son sexe. La répartition se faisait selon les lois alimentaires ancestrales. Je ne me souviens pas d’un seul cas où une mère ait mangé un enfant qu’elle avait initialement laissé en vie.
Quant au terrible Dowie, un tueur et un cannnibale impéninent dont elle relate la biographie, elle affirme que son goût pour la chair humaine s’était développé du fait que « lorsqu’il n’était encore qu’un petit enfant, on lui avait donné quatre de ses sœurs à manger, et on l’avait enduit de leur graisse ».
Tout le problème, dans ce cas, tient dans la fiabilité et la précision des informations – il va sans dire qu’étant donné la manière dont de telles coutumes étaient perçues par les Occidentaux, en particulier par les représentants de l’État et de l’Église, les Aborigènes n’étaient sans doute pas particulièrement désireux de leur donner de la publicité. Deux questions, en particulier, se posent : la première est de savoir si l’on ne mangeait que des enfants déjà morts (rappelons que comme dans toute population pré-jénerienne, un bon quart des enfants décédait avant d’atteindre deux ou trois ans) ou si on les tuait dans ce but - voire dans un autre, l’infanticide pouvant également être motivé par des naissances trop rapprochées. L’autre inconnue porte sur le caractère récurrent ou exceptionnel de telles pratiques. Survenaient-elles en cas de disette ? Étaient-elles un contrecoup de l’arrivée des Occidcentaux et des ravages que leur présence avait occasionné sur ces populations ? Sur ce point, je laisserai la conclusion (nuancée) aux deux éminents spécialistes que sont Catherine et Ronald Berndt :
La prévalence du meurtre et de la consommation des très jeunes enfants a été à la fois grossièrement exagérée et sous-estimée, par exemple par Basedow (1925 : 21). L’infanticide semble avoir été pratiqué occasionnellement dans presque toute l’Australie aborigène, mais il ne peut avoir été aussi fréquent que le suggèrent Taplin, dans Woods (1879 : 13-15) et Bates (1938). L’infanticide n’est pas non plus systématiquement suivi de la consommation de la chair : lorsque cela se produit, l’idée derrière cet acte est l’espoir que l’enfant renaîtra ou que la force sera transmise à un autre enfant. Les enfants ne sont pas tués sans discernement : les mauvaises saisons dans les zones désertiques en sont la cause dans certains cas, l’espacement des naissances dans d’autres. Howitt rapporte que les nouveau-nés sont tués pendant les étés difficiles, en période de sécheresse ou lorsque la mère a d’autres enfants à charge.
Quoi qu’il en soit, et pour en revenir au cannibalisme judiciaire, il semble avoir connu au moins une autre occurrence, chez un peuple de cultivateurs de Sumatra, les Bataks. Des témoignages du 19e siècle indiquent qu’il frappait « certains crimes, notamment l’adultère ». Le modus operandi était particulièrement cruel :
Le prisonnier ou le criminel est attaché à un poteau ; tout le village se rassemble et, après que quelques orateurs ont décrit en détail les crimes commis par le condamné, le plus éminent de l’assemblée, ou la personne offensée par le crime, coupe le nez de la victime, le trempe dans un récipient contenant du jus de citron et le mange comme une huître. Puis un autre lui coupe les joues, un autre encore en retire les entrailles avec la paume de la main, et ils mangent ces morceaux sous les yeux du condamné à mort, puis tout le monde se jette sur le cadavre. La durée des souffrances dépend beaucoup de la gravité du crime, mais aussi de la présence de personnes particulièrement animées de haine. Il faut toutefois mentionner que les jeunes femmes ne participent pas à cette fête et ne mangent pas la viande. (Von Kessel, « Eine Reise in die Nord Unabhangigen Battaländer von Klein Toba auf Sumatra », Das Ausland Stuttgart n°27, 1854, p. 739)
Pour finir, notons que la prise en compte de cette éventualité du cannibalisme judiciaire ne remet nullement en cause les conclusions de Bruno Boulestin et Dominique Henry-Gambier sur la grotte du Placard : dans le cas présent, en raison de la pyramide des âges des victimes cannibalisées permet de l’écarter fermement.


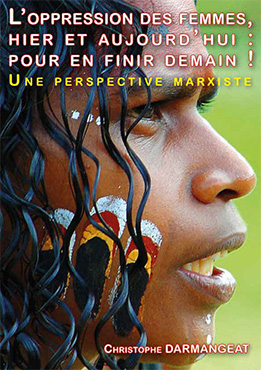

Est-ce que ça confirme ce qu'en dit Georges Guille-Escuret dans sa Sociologie comparée du cannibalisme (que je n'ai pas fini) ? Je crois que pour le coup il est parvenu à rendre compte d'une grande diversité de cannibalisme notamment en intégrant les dynamiques historiques
RépondreSupprimerHélas, je ne suis jamais parvenu à lire plus de quelques pages de ce regretté auteur. C'était un penseur fort intéressant, que j'ai eu la chance de fréquenter trop brièvement, mais son style baroque me paralyse totalement.
SupprimerC'est dommage ! Concernant le cannibalisme il me paraît assez incontournable ne serait-ce que par son caractère de "tour du monde" et peut-être encore plus pour la leçon méthodologique d'anthropologie symétrique. Au passage c'est un travail qui critique subtilement, sans trop le dire, les ontologies de Descola en s'appuyant sur des propositions plus maîtrisables de ce dernier. GGE n'était-il pas dans votre jury d'HDR ?
SupprimerMieux que cela : il était mon garant. Mais pour en revenir à ses écrits, rien à faire, à chaque fois que j'ai essayé, j'ai renoncé. Je n'en tire pas de fierté particulière...
SupprimerAlors ok on rétabli la peine de mort mais le juge qui a prononcé la sentence doit manger le supplicié
RépondreSupprimerUne variante de « Car le juge, au moment suprême / Criait : 'Maman !', pleurait beaucoup / Comme l’homme auquel, le jour même / Il avait fait trancher le cou. » ?
SupprimerMon commentaire n'apparait pas : j'avais lu dans "Psychanalyse et Anthropologie" de Geza Rohein (1969) qui s'appuyant sur Daisy Bates écrivait qu'une des coutumes des tribus du sud était de manger et partager avec ses sœurs leur premierr bébé ... (1969, 97). J'avais repris ça dans ma thèse mais il y a eu des contestations ...
RépondreSupprimerJe ne sais évidemment pas comment vous avez utilisé l'information. Spontanément, je dirais qu'elle n'est pas totalement invraisemblable, mais qu'il faut quand même la prendre avec des pincettes. On n'a aucun témoignage équivalent, et même si elle est vraie, elle peut être liée à une situation de désarroi et d'effondrement qui n'est pas significative des coutumes traditionnelles de ces sociétés.
SupprimerRien de nouveau sous le soleil : une forme « judiciaire » (ou « juridique ») du cannibalisme est identifiée depuis très longtemps (déjà dans les années 1880 par Letourneau ou Lombroso), et si elle n’est pas extrêmement répandue, elle n’est pas non plus rarissime. L’exemple canonique est celui des Bataks, traité par G. Guille-Escuret dans son volume 2, p. 138 et suivantes. Sauf que cette forme ne se rattache pas à l’endocannibalisme, mais à l’exocannibalisme, et il y a d’excellentes raisons qui justifient cela. Ce n’est pas « guerrier » au sens propre (ce pour quoi sur ce plan l’équivalence n’est que « pratiquement » parfaite), mais les victimes sont traitées comme des ennemis, ce qui s’explique très bien dans un cadre conceptuel général.
RépondreSupprimerA la limite, tout est exo-cannibalisme, car ceux qu'on mange ce sont tous ceux qui ne font pas partie de son propre groupe, soit parce qu'ils font partie d'un autre, soit parce qu'ils faisaient partie du sien mais sont morts ou ont été exclus à cause d'une faute, soit parce qu'ils n'en font pas encore partie et donc on peut en faire ce qu'on veut avant qu'ils y soient inclus... Est-ce à dire que c'est seulement la contrainte sociale qui empêche le cannibalisme généralisé? On risque tous donc d'être mangés lorsqu'on suit pas l’étiquette? Ou lorsqu'on arrive nouveau dans un groupe quelconque? Citons ici Lévi-strauss: « Vous m’avouerez qu’il y a de quoi s’interroger sur l’homme. C’est le rôle de l’anthropologie, direz-vous. Hélas — ou faut-il dire heureusement ? — elle n’a pas réponse à tout » (dernière phrase de son entretien avec D. Eribon).
RépondreSupprimer