Une (très bonne) conférence sur les origines de la guerre

Il y a quelques mois de cela, j’ai été contacté par un collègue qui travaillait à un ouvrage sur les origines de la guerre. Il voulait vérifier certains éléments concernant les données ethnologiques, en particulier celles qui concerne les sociétés de chasseurs-cueilleurs. J’ai très rapidement vu que j’avais affaire à un interlocuteur extrêmement sérieux, pour qui la science commençait par le fait de vérifier scrupuleusement ses informations et ses raisonnements, et à ne pas se contenter d’à-peu-près. Notre communauté de pensée ne s’arrête pas là : Hugo Meijer, puisque c’est de lui qu’il s’agit, tient à formuler des propositions claires et à avancer des hypothèses qui peuvent être discutées, c’est-à-dire infirmées ou confirmées. C’est loin d'être toujours le cas, et en sciences sociales, ainsi que le dit Jean-Loïc Le Quellec dans une de ses boutades favorites, on a trop souvent l’impression de lire ou d’entendre des propos qui ne sont « même pas faux ». Il est bien dommage que ces contacts se soient noués à peine quelques semaines après le colloque toulousain consacré aux conflits dans les sociétés sans richesse : Hugo y aurait naturellement eu sa place, et il y aurait constitué un apport précieux.
Toujours est-il que ce collègue a récemment été invité par Jean-Jacques Hublin, du Collège de France, pour exposer ses travaux qui, dans quelques mois, vont donner lieu à une (épaisse) publication en anglais. Sur le fond, cette conférence est tout à fait intéressante et sur la forme, d’une grande clarté et accessible à tous les non-spécialistes : je ne saurais trop en recommander le visionnage.
Les points abordés recoupent en partie ceux que je traite dans mon propre bouquin à paraître, et on pourrait naturellement tirer bien des fils à partir de son propos. Les données archéologiques pour les chasseurs-cueilleurs, en particulier, d’une interprétation si difficile, appelleraient une discussion serrée, qui ne saurait être menée dans le seul cadre d’un exposé oral.
Quoi qu’il en soit, si j’avais une seule remarque à faire, c’est que la dualité guerre / paix (ou conflit / collaboration) peut et doit être affinée pour décrire les relations entre des groupes. En particulier, les humains ont inventé des « conflits pacificateurs », ces confrontations que j’appelle résolutives et conventionnaires, qui possèdent un caractère judiciaire : ce sont celles où, dans un cadre convenu par avance entre les deux parties, la violence a pour objet de vider le ressentiment et de permettre aux protagonistes d’en revenir à des relations plus apaisées.
Un dernier détail : les plus attentifs noteront quelques bizarreries dans les noms de certains peuples figurant sur les diapositives projetées par Hugo. Ce sont de simples coquilles, qui n’enlèvent rien au sérieux du propos.


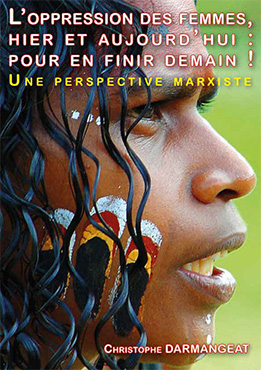

Je l'ai visionner ce matin ..
RépondreSupprimerMerci, très bonne référence. En voici une autre un peu plus « grand public » sur le sujet de la guerre chez les animaux: L. Bollache, Quand les animaux font la guerre (2023) / https://www.youtube.com/watch?v=WVqPamM-6ng. Il semble qu'on dépasse pas l'imaginaire de la dichotomie Rousseau/Hobbes lorsqu'on parle de ces sujets.
RépondreSupprimerMa critique sur ce livre : https://www.afis.org/Quand-les-animaux-font-la-guerre
SupprimerC'est dense, il aborde vraiment beaucoup d'aspect différents
RépondreSupprimerLa psychologie évolutionnaire est une discipline particulièrement rejeté par les scientifiques fréquentant ma bulle de filtre et j'en suis vraiment très étonné car, par exemple, ce que fait Hugo Meïjer semble parfois en être. D'après toi ce rejet te semble t il justifié ?
RépondreSupprimerLa très bonne chaîne https://homofabulus.com/ parle extensivement du sujet, voyez par exemple cet article https://homofabulus.com/la-science-progresse-un-enterrement-a-la-fois/ . En gros et pour résumer, à gauche, parler de déterminismes qu'ils soient génétiques, biologiques, etc c'est très mal vu. Or les scientifiques (en particulier en sciences sociales) sont de gauche, donc rejettent aussi bien la psycho évo, qu'en son temps Bourdieu, etc. Bref, ils sont hélas idéalistes et pas matérialistes.
SupprimerBien entendu, refuser d'admettre les déterminismes c'est se condamner à échouer à les combattre. La dernière fois que j'ai parlé de la brochure de C. Darmangeat "l'oppression des femmes..." dans un environnement de militants d'extrême gauche, on m'a dit que c'était (je cite) une "merde masculiniste"...
C'est tout de même un peu plus compliqué que cela, à tous points de vue. Déjà, je suis moi-même marxiste et d'extrême-gauche, et ce je raconte est accueilli avec intérêt par un certain nombre de gens qui partagent ces orientations (ce qui ne veut pas dire qu'ils sont toujours d'accord avec tout ce que je dis, mais c'est bien normal !). Et la tradition marxiste est justement celle qui insiste sur les déterminismes qui pèsent sur les humains et leurs consciences. Après, qu'il y ait à gauche (extrême ou non) des gens qui tournent le dos à ces traditions, soit en les récusant, soit en s'en réclamant mais en adoptant en pratique l'attitude inverse, c'est malheureusement vrai. Mais il est donc difficile de faire des généralités.
SupprimerQuant à la psychologie évolutionniste, j'évite de trop en parler (même si je lui ai consacré un billet de ce blog) mais j'ai tout de même le sentiment que parmi les différentes approches, c'est une des plus spéculatives et dont les résultats ne sont guère probants. Et c'est, me semble-t-il, également l'avis de collègues biologistes. Maintenant, je peux me tromper et ne revendique clairement pas une expertise sur le sujet.
Je suis aussi marxiste et d'extrême-gauche, mais quand j'entends par exemple dans le cours d'autodéfense intellectuelle (par ailleurs plutôt pas mal) de Richard Monvoisin que les êtres humains ne sont plus soumis aux lois de l'évolution ((cours 8, partie 3, Université de Grenoble-Alpes), je ne peux que constater que le matérialisme strict se perd...
SupprimerVu comme cela, cela ressemble à l'idée dite de l'effet réversif de l'évolution, souligné par Patrick Tort à partir des écrits de Darwin. Sauf erreur, il est évidemment erroné de le formuler de manière aussi catégorique (mais s'il s'agit d'un propos oral, cela peut s'excuser), mais dans l'ensemble il me semble l'idée est fondamentalement juste et intéressante.
SupprimerComme je le comprends, l'effet réversif est à rapprocher de l'évolution mémétique de Dawkins : les caractères qui dirigent effectivement l'évolution humaine ne sont pas limités aux contraintes matérielles et environnementales, mais peuvent être des contraintes de second ordre, y compris culturelles, sociales, etc ; cependant le mécanisme fondamental des lois de l'évolution continue à fonctionner; simplement le "filtre" peut être spécifiquement "immatériel", comme l'objet auquel il s'applique éventuellement (le mème). Je crains fort que dans le cas cité, l'approche était plutôt naïvement prométhéenne, dans l'idée que "les humains sont au-dessus des lois de la nature désormais". Faudra que je vérifie, ça date un peu mais à l'époque ça m'avait enragé :)
SupprimerJe crois que vous faites erreur. L'effet réversif tient dans la formule : "la sélection naturelle engendre des comportements sociaux qui s'opposent à la sélection naturelle". Jetez un oeil sur ces pages de Patrick Tort :
Supprimerhttps://www.persee.fr/doc/raipr_0033-9075_1989_num_92_1_2813
L'effet reversif de la sélection naturelle est une analyse dialectique de la selection naturelle appliquée à l'homme.
SupprimerLa sélection naturelle a favorisé certains traits chez l'homme, notamment sa capacité à collaborer, ce qui permet a l'humanité de s'extraire des mécanismes brutaux de la selection naturelle
Tout à fait - j'ajouterai simplement une nuance : de s'extraire dans une certaine mesure des mécanismes de la sélection naturelle. ;-)
SupprimerIl me semble qu'il s'agit d'une manière différente d'exprimer la même chose, mais en la tournant différemment :) l'amélioration de la coopération et la réduction de la compétition induisent une variabilité plus grande des caractères, et donc un plus grand potentiel d'adaptation face à l'évolution des conditions. C'est le bon côté de la sélection naturelle : ça marche toujours, même pour expliquer les comportements de coopération, y compris entre espèces d'ailleurs. J'ai lu un bouquin passionnant sur la question qui s'appuyait sur l'étude du rat-taupe nu, faudrait que je retrouve les références...
SupprimerTort et Dawkins ne disent pas la même chose.
SupprimerTort voit la culture comme une réponse évolutive au biologique (darwinisme appliqué à la civilisation).
Dawkins voit la culture comme un processus autonome de réplication (darwinisme appliqué aux idées).
Très intéressant! D'un point de vue praxéologique, la référence à 1:01 aux armes du type projectile nous invite à réfléchir sur la nécessité croissante de faire la guerre/chasser avec des outils qui demandent un certain "calcul", et le fait que les rapports pacifiques se co-développent (démarche qui nécessite elle aussi d'un calcul du type coût-avantage plus poussé). Plus concrètement, le calcul du projectile a peut-être progressivement développé notre capacité d'abstraction, nécessaire au développement des rapports sociaux (empathie, plans sur le long terme lors d'une négociation, etc.).
RépondreSupprimerTrès très intéressante conférence. Je suis un béotien. Je m'intéresse à la question de l'auto-domestication et à la sélection de comportements de collaboration / comportements altruistes. J'ai le sentiment en effet que le premier animal que l'humanité a cherché à domestiquer c'est elle-même. Les comportements altruistes nécessitent en effet de dépasser les réactions pour se projeter dans un futur où l'autre peut être un secours dans une situation où je serais dans le besoin. On peut imaginer qu'une sélection sociale de ce type de compétence ait permis son développement, qu'elle ait tout à la fois entraîné une diminution de l'expression de l'agressivité envers ses congénères (génétiquement) ou bien qu'elle ait permis le développement d'une culture de la collaboration de génération en génération avec le développement du langage et de sa précision (transmission adulte-enfant). Bref, c'est un sujet que j'aimerais, en amateur, creuser. Je pense qu'une bonne partie du malaise lié aux risques psycho-sociaux sont en lien avec une contradiction, pour le dire vite, entre une structure corticale à but altruiste et une société de compétition.
RépondreSupprimer