Droit de la guerre et esclavage : à propos d'un texte d'Alain Testart
 |
| Indiens Pomo de Californie (John Greenleaf Cloudman, 1852) |
Dans son article « Autour du droit de pillage » (Droit et cultures 45/1, 2003), Alain Testart abordait le cas de deux régions (la Californie et la Nouvelle-Guinée) qui, à ses yeux, se distinguaient par un double caractère exceptionnel : d’une part, elles étaient les seules dans lesquelles les guerres, loin d’ouvrir au vainqueur la possibilité de s’enrichir au détriment du vaincu en le pillant, l’appauvrissaient en l’obligeant à indemniser l’adverseraire défait. Une telle coutume constituait selon lui un « principe étonnant dont il n’est pas besoin de souligner le caractère singulier qui l’oppose à tout ce que l’on connaît en Occident » ; d’autre part, ces régions étaient également dépourvues d’esclavage, un trait fort rare dans les sociétés structurées par la richesse. Et il établissait un lien de causalité entre les deux phénomènes.
Avant d’en venir au cœur du propos, on remarquera que dans ce texte, le terme de guerre désigne (au moins de manière implicite) l’ensemble des opérations militaires. La guerre n'est notamment pas différenciée de la razzia, une distinction qui ne sera introduite dans son œuvre que plusieurs années après, dans un manuscrit inédit sur L’Etat, le droit, la guerre, où il opposera « engagements à finalité limitée »(dont la razzia) à la guerre proprement dite.
Quoi qu’il soit, Testart écrit ainsi :
Sur les Hautes Terres de Nouvelle-Guinée (...), la fin des hostilités est marquée par le versement d’indemnités (analogues en leur principe à un wergeld) pour tous les tués au combat. Certes, il existe de nombreuses dérogations à ce principe qui n’est pas toujours appliqué dans les faits, et peut-être ne vaut-il pas dans tous les types de guerres, mais le principe est reconnu.
La phrase finale montre qu’il y a anguille sous roche : un principe qui en pratique admet des dérogations est une chose, mais un principe qui, si l’on ose dire, ne s’applique pas par principe dans certaines circonstances en est une autre. Et c’est bien le problème sur lequel on va revenir : tout en qualifiant (à tort) tous les affrontements de « guerres », Testart suggère ici fort justement qu’il en existe différents types, aux règles et à la logique très différents les uns des autres.
Sur l’indemnisation finale, le texte évoque plusieurs cas californiens, dont celui des Yurok, par la plume de d’Alfred Kroeber :
Lorsque l’on arrivait à un accord pour mettre fin aux hostilités, la base exclusive de cet accord était le suivant (sic) : tous les dommages donnaient lieu à indemnités. Pour chaque homme tué ou blessé, on payait selon son rang, toutes les femmes et tous les enfants capturés étaient rendus, on payait aussi pour les maisons brûlées et les biens dont on s’était emparé étaient retournés. Il semble que chacune des parties payait effectivement à l’autre l’ensemble de ce qu’il lui devait {et il n y avait pas de compensation dans les comptes (...) De toutes façons, c’était le vainqueur qui avait la charge financière la plus lourde. (...) le vae victis de la civilisation pourrait bien avoir été remplacé chez les Yurok. au moins au sens financier, par le dicton : « Malheur aux vainqueurs »
Sur un peuple voisin, les Pomo, l’article fournit une référence à côté de laquelle je suis passé lors de mes recherches pour rédiger mon prochain livre. Dommage : elle m’aurait évité d’écrire la bêtise selon laquelle on ne dispose de presque aucune information sur ce peuple. Le livre de Loeb, Pomo folkways, paru en 1926, consacre en fait plusieurs pages à la « guerre » – en réalité, là aussi, à diverses modalités d’affrontements. Il n’est pas facile de mettre de l’ordre dans cet exposé, qui ne suit pas un plan systématique. On discerne toutefois trois types de confrontations :
- l’expédition de vengeance, menée en (relativement) petit groupe, et dont la motivation principale est la conviction que les morts n’étaient que rarement naturelles : « Étant donné qu’on attribuait une grande part des maladies et des morts à l’empoisonnement par des étrangers, cette façon de penser maintenait les villages voisins dans un état de suspicion mutuelle et engendrait des représailles armées ».
- des batailles rangées, menées exclusivement à distance et qui, malgré les effectifs parfois nourris qu’elles mobilisaient, faisaient tout au plus deux ou trois morts.
- des épisodes durant lesquels on massacrait l’ennemi sans merci : Loeb rapporte ainsi un conflit où un village en extermine un autre, faisant cinquante victimes (hommes, femmes et enfants).
Le point crucial est que l’indemnisation des victimes, celle qu’évoque Kroeber et sur laquelle s’appuie le raisonnement de Testart, n’intervient manifestement que dans les deux premiers cas, et nullement dans le troisième. Ces données ressemblent de manière saisissante à celles dont on dispose sur les Dani des hautes-terres de Nouvelle-Guinée, avec leurs deux formes de « guerre » : celle qu’Heider appelait rituelle, marquée par un nombre de victimes faibles et une paix impliquant le paiement de compensations, et celle qu’il appelait séculaire, très meurtrière et ne donnant lieu à aucune indemnisation.
Testart soulignait l’originalité que constituait, à ses yeux, de telles pratiques :
Dans des formes très similaires, et à quelques détails près, les deux aires culturelles que sont la Californie et les Highlands de Nouvelle-Guinée mettent en jeu un système étonnamment semblable de règlement des conflits. Et un système suffisamment rare dans le monde - on n’en voit pas d’autres exemples - pour qu’il convienne de s’interroger sur ses implications. La première est qu’elle (sic) rend le pillage, soit des hommes soit des choses, une opération fort peu intéressante, ni rentable ni profitable, car il faudrait compenser pour chaque bien obtenu ou chaque homme capturé. Cela reviendrait à les acheter, et on ne voit pas ce que l’on gagnerait à faire une guerre. Ce système de compensation guerrière, s’il est systématique, anéantit jusqu’à l’idée même de butin.
Et comme on l’a dit, il voyait là l’explication de l’absence de l’esclavage :
Ce fait doit être rapproché de nos données sur l’esclavage. Dans un précédent travail systématique sur l’esclavage précolonial, nous avions été surpris de constater que trois aires, et trois aires seulement (en dehors de sociétés qui ne pratiquaient aucunement l’esclavage comme les chasseurs-cueilleurs nomades), ne pratiquent pas l’esclavage : une partie de l’est africain, la Californie et la Nouvelle-Guinée. Au moins en ce qui concerne les deux dernières, il nous semble que le système de compensations qui mettent fin à la guerre suffit à expliquer ce manque.
Ce raisonnement soulève, me semble-t-il, deux objections. La première tient au fait que même si les deux éléments du problème (compensation systématique et absence d’esclavage) étaient assurés, on ne voit pas bien ce qui permettrait d’établir un lien de causalité de la première vers la seconde. Que la présence des compensations systématique explique pourquoi, dans le cadre d’un conflit, on ne peut s’emparer de captifs sans avoir à les payer, c’est une chose. Mais qu’est-ce qui empêcherait, dans ce cas, qu’existe un esclavage marchand, et/ou un esclavage pour dettes (le second alimentant éventuellement le premier) ? Sur un plan purement logique, la compensation systématique en cas de conflits peut donc tout au plus rendre compte de l’absence d’une modalité précise de l’esclavage, mais non de celle de l’esclavage en général.
L’autre objection est que l’étrangeté des guerres des Californiens et des Néo-Guinéens – les vainqueurs indemnisant les vaincus – s’évanouit dès lors que l’on considère ces conflits pour ce qu’ils sont réellement, à savoir non des guerres visant à imposer quelque chose à l’adversaire, mais des affrontements de compensation ayant pour objectif de rétablir un équilibre perturbé. Certains de ces affrontements, parce qu’ils obéissent à une logique discrétionnaire et qu’ils se prolongent, se rattachent à la catégorie spécifique des feuds. D’autres, parce qu’ils sont menés de manière conventionnaire et que les deux camps savent par avance qu’il faut atteindre une parité de dix tués de chaque côté, relèvent d’un autre type. Mais dans les deux cas, le paradoxe d’une guerre qui représenterait un fardeau financier pour le vainqueur se dissipe de lui-même : si fardeau financier il y a, c’est précisément parce que ce ne sont pas des guerres et que par définition, elles ont pour but de ne pas avoir de vainqueur : elles ne sont menées que pour parvenir à un match nul, les vies et les richesses étant décomptées dans un même score global.


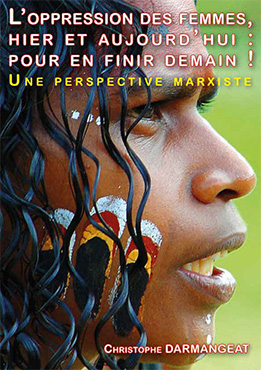

Aucun commentaire