Parution annoncée : Casus belli. La guerre avant l'État (éd. La Découverte)

À peine avais-je écrit mon précédent billet au sujet de la relecture des épreuves de mon manuscrit, que La Découverte annonçait publiquement son programme de parution pour les mois à venir. Donc, fin du suspense : mon prochain livre, annoncé pour le 28 août au prix de 23 €, s’intitule Casus belli, avec comme sous-titre La guerre avant l’État. Il sera publié dans la formidable collection Sciences sociales du vivant, dirigée par Bernard Lahire.
Avant de reproduire ci-dessous sa présentation par l’éditeur, je tiens à remercier chaleureusement l’ensemble des internautes plus ou moins anonymes dont les remarques et les suggestions ont nourri sa rédaction. J’espère qu'ils liront ces lignes... et que nous aurons l’occasion de nous rencontrer en chair et en os.
À quand remonte « la » guerre ? Pour quelles raisons la menait-on ? Dans un style accessible teinté d’humour, Christophe Darmangeat apporte une profondeur inédite à ces questions en élargissant la focale au-delà du prisme de la guerre telle que nos sociétés étatiques la définissent. Grâce à une approche comparative interdisciplinaire sans équivalent, il propose pour la première fois une typologie générale des confrontations collectives qui éclaire d’un jour nouveau les logiques sociales qui ont présidé à leur évolution.
Il est souvent admis que la guerre authentique ne naît véritablement qu’à une époque tardive, à l’Âge du bronze – cette période étant supposée être celle de l’apparition à la fois d’une spécialisation de l’activité martiale, avec des combattants professionnels, et de l’armement spécifiquement homicide, avec l’épée. Inversement, il existe à l’échelle internationale un courant qui plaide pour une origine très ancienne de la guerre. Cette thèse, qui inscrit la question dans le temps long de l’évolution biologique, relie la guerre des sociétés humaines aux observations effectuées sur les primates, en particulier les chimpanzés.
Quelles que soient leurs divergences, ces approches partagent l’idée que la guerre est intimement et nécessairement liée à l’appropriation de ressources. C’est notamment cette idée que Christophe Darmangeat entend contester, sur la base de multiples données ethnographiques qui dépeignent des conflits armés collectifs et homicides – dont certains seulement relèvent de la guerre stricto sensu –, y compris dans des sociétés de chasse-cueillette mobile dénuées de toute inégalité de richesse. Ces conflits sont menés pour d’autres motifs que l’appropriation de ressources territoriales, humaines ou matérielles, en particulier la vengeance ou l’acquisition de substances corporelles (le plus souvent des têtes, mais aussi des dents, des scalps…) réputées nécessaires à la vie.
Dans une large perspective comparatiste et une approche interdisciplinaire nourrie par l’éthologie, l’ethnologie, l’histoire et l’archéologie, ce livre ambitionne de recenser ces diverses formes de conflits armés, d’en proposer une typologie raisonnée, de les mettre en relation avec les structures sociales et de traiter de leur visibilité – ou plutôt, le plus souvent, de leur invisibilité – archéologique.


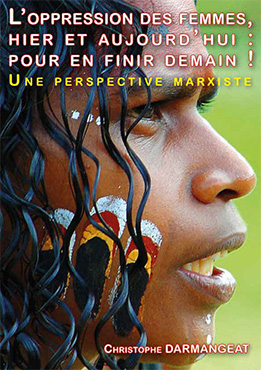

Je suis désolé de casser un peu le truc... Mais le deuxième terme ce sont des "ressources" aussi...
RépondreSupprimerUne ressource imaginaire est-elle une ressource ? ;-)
SupprimerBien sûr. Comme les nombres imaginaires sont des nombres :-)
RépondreSupprimerPlus sérieusement : comme un placebo a un effet réel, mesurable. Comme les vertus imaginaires de "l'élite" assurent sa domination réelle.
Eh non. Qu'un phénomène imaginaire puisse avoir des effets réels est une chose. Mais qu'un phénomène imaginaire soit lui-même réel est une chose toute différente. Si je vous donne une augmentation de salaire imaginaire en vous disant qu'elle est réelle, peut-être irez vous fêter cela au restaurant. Mais vous finirez avec une dette chez le banquier...
SupprimerUne dette, et la monnaie fiduciaire en général, c'est réel ou bien c'est un effet de croyance ?
SupprimerJe vous concède que mon exemple prête le flanc à la discussion. Alors soyons plus directs et terre à terre : que devient un individu qui se nourrit exclusivement d'aliments imaginaires ?
SupprimerEt moi, je concède volontiers qu'il meurt... Comme mourrait un individu qui se nourrirait exclusivement de cailloux, pourtant bien réels !
SupprimerSeulement, personne ne fait ça. Personne ne se nourrit de cailloux, ni exclusivement d'aliments imaginaires (sauf Mechtilde de Magdebourg, 1207-1283, qui se nourrissait du Christ). En revanche, la plupart des gens, pour ne pas dire tous, accordent aussi une grande valeur imaginaire à leurs aliments. Et cette valeur n'est pas séparable, dans l'effet que produit l'aliment, du contenu nutritif "objectif" mesurable par la chimie. Je mets des guillemets à ce mot, parce que l'effet placebo lui aussi est objectif et mesurable, et d'ailleurs a été mesuré maintes fois. D'où l'idée que formulait l'Anonyme n°1, que les ressources imaginaires sont aussi des ressources...
M.G.
Dire que la valeur imaginaire (ou symbolique) attachée à un aliment « n'est pas séparable, dans l'effet que produit l'aliment, du contenu nutritif "objectif" mesurable par la chimie. » est tout simplement faux. Donnez à quelqu'un son aliment favori, dont vous aurez auparavant retiré, à son insu, les composants nutritifs, et l'individu dépérira. Inversement, nourrissez-le par perfusion, sans qu'il ait la moindre idée de ce qui se trouve dans le liquide, et il survivra. C'est toute la différence entre accorder l'importance nécessaire aux dimensions idéelles de la réalité, et en arriver à nier toute différence entre ces dimensions idéelles et les dimensions réelles.
SupprimerPour en revenir à la chasse aux têtes, que les gens qui la pratiquent soient convaincus que les têtes constituent une ressource est une chose. Pour autant, prendre leurs croyances pour argent comptant et considérer qu'elles en sont une, au même titre que la terre ou l'eau, c'est passer complètement à côté du problème et s'interdire, du coup, de comprendre qu'il y a justement quelque chose à expliquer.
J'ai juste dit "pas séparable", je n'ai pas dit "identique"... La dimension imaginaire et affective de la nourriture n'est évidemment pas tout, mais elle est essentielle : même bien fourni en nourriture, un petit singe isolé dépérit. Il ne s'alimente vraiment qu'en présence d'une mère de substitution faite de chiffons, c'est-à-dire une mère IMAGINAIRE (expériences de Harlow).
SupprimerMais je ne vais pas envahir plus longtemps ce beau blog. Je vais plutôt lire Casus belli, et je m'en délecte à l'avance. Merci pour tout ce travail !
M.G.
M.G. : votre argument ne marche pas il me semble. L'attachement comme les aliments sont des ressources "nécessaires à la vie", dont on peut extraire des éléments vitaux : les nutriments donnés en perfusion à la place des aliments, et je ne sais pas trop quoi (la forme ? la texture ? l'odeur ?) dans la mère en chiffon donnée à la place de la vraie mère. Si la poupée de chiffon fonctionne, c'est justement parce qu'elle fournit ces éléments matériels, je crois. Après je n'en déduis rien sur le fond de la discussion qui précède, je n'y ai pas réfléchi.
SupprimerBonsoir, Nadine. Je voulais juste dire que "l'attachement comme les aliments sont des ressources nécessaires à la vie" : apparemment, vous êtes d'accord. C'est tout ce que je voulais dire, par cet exemple.
SupprimerPar extension, je crois - mais je ne suis pas spécialiste - que les ressources appelées plus haut imaginaires (p. ex. chasse aux têtes) font partie des ressources, comme l'a signalé tout au début l'Anonyme n°1. Dans le sens où elles sont nécessaires pour que certains processus fonctionnent. Ça ne veut pas dire que je prends pour argent comptant ce que pensent les chasseurs de têtes : en fait, ce qu'on pense de leurs croyances n'a aucune importance, sauf pour nous, et n'a rien à voir avec le processus lui-même. De même que pour se nourrir, le bébé singe a besoin de la présence d'une mère imaginaire... Et ça ne veut pas dire que je crois ce que pense le singe, d'ailleurs je n'en sais rien !
Si j'ai bien compris ce que vous avancez comme un contre-argument, c'est que la matérialité de la mère imaginaire la ramène forcément au niveau "ressources réelles". Ça me semble un peu hors sujet (les têtes coupées aussi, sont réelles) car ce dont a besoin le bébé singe, ce n'est pas de tel ou tel matériau ou texture, c'est d'un ensemble produisant une vague évocation sur laquelle il puisse projeter.
Que, ensuite, chacune de ces ressources dites réelles ou dites imaginaires puisse être décomposée en éléments matériels, je suis d'accord, mais je ne vois pas ce que cela change. Pour planter un clou dans une planche, il faut un marteau, qui a une tête et un manche. Si on utilise le bois du manche comme rouleau à pâtisserie et le métal de la tête pour forger un fer de lance, on a toujours la même quantité de bois et de fer, mais on n'a plus de marteau, et on ne peut plus planter un clou. Idem pour le bébé singe : ce n'est pas la forme ou la texture (quoiqu'elles soient très importantes) mais l'ensemble. Et idem, je pense, pour la chasse aux têtes : je suppose que ce qui compte (mais encore une fois, je ne suis pas spécialiste) c'est moins la matérialité d'une tête avec ses dents, ses cheveux, etc., que l'évocation d'une vengeance ou d'un exploit guerrier, les conditions dans laquelle elle a été coupée, les rites associés, etc.
Comme quoi il ne faut jamais prendre non plus pour argent content la promesse d'un Marc Guillaumie de mettre un terme à ses interventions. Il a de la ressource... ;-)
SupprimerBlague à part, Marc écrit que les ressources imaginaires sont une ressource « dans le sens où elles sont nécessaires pour que certains processus fonctionnent ». Certes. Mais qu'apportent-elles de réel à ceux qui les captent, là est la question à laquelle il s'agirait quand même de répondre. Et je suis désolé de reprendre ce type d'exemple, mais le paysan qui se satisferait d'une parcelle de terrain imaginaire au prétexte qu'elle constitue tout de même une ressource à condition d'en être persuadé serait tout de même bien naïf, pour ne pas dire plus.
C'est pas ma faute, c'est pas moi, c'est Nadine qui m'a relancé !
SupprimerJe blague... Il me semble qu'on tourne un peu en rond, quant à ce qu'on appelle "réel". On ne va pas régler ça en quelques lignes. Alors, j'arrête.
... jusqu'à la prochaine, bien sûr ! :-)
Bonjour,
SupprimerC’est vrai, c’est moi qui relance:)
J’ai tenté une clarification :
Choses A : choses matérielles vitales
Choses B : choses matérielles déclenchant des processus aboutissant à l’accès à des choses vitales
Choses C : choses matérielles non-A et non-B
Choses D : choses immatérielles vitales
Choses E : choses immatérielles déclenchant des processus aboutissant à l’accès à des choses vitales
Choses F : choses immatérielles non-D et non-E
Dans ce qu’on a dit plus haut, dans les contextes énoncés :
Choses A : aliments, nutriments, poupée de chiffon (selon moi)
Choses B : aliments, têtes coupées, poupée de chiffon (selon Marc), placebo
Choses C : cailloux
Choses D : ?
Choses E : placebo, vertus de l’élite
Choses F : augmentation de salaire imaginaire, aliments imaginaires, champ imaginaire
(je n’ai pas classé dette et monnaie fiduciaire parce que je ne maîtrise pas ces termes).
Le classement est forcément lié au contexte, par exemple on voit bien que ce qui est F pour l’un peut être E pour l’autre.
Question résiduelles : existe t’il des choses D ?
J’ai choisi « immatériel » plutôt qu’« imaginaire » (qui peut nous perdre par son opposition avec réel) mais pour être bien précis on pourrait dire «choses cognitives » : croyances, savoir, langage, imaginaire… (les choses cognitives ayant évidemment une base matérielle dans notre cerveau).
Quant à ce qui peut être appelé « ressource », c’est une question de convention, il faut juste se mettre d’accord : seulement les choses A (et D), ou les choses A, B, (D) et E.
bien à vous.
Nous avons là un joli sujet (et une première proposition méritoire) pour des réflexions futures ! Mais en ce qui me concerne, je ne pense pas avoir de temps de cerveau disponibles pour les prochaines semaines). C'est effectivement à un classement qu'il faudrait travailler, et comme toujours, ce sera l'occasion de se demander quels sont les bons critères pour délimiter lignes et colonnes. Un premier mouvement : je ne crois pas qu'on puisse dire que le placebo « déclenche l'accès à des choses vitales ». Au mieux, c'est impropre, au pire, c'est faux (encore une fois, à réfléchir !)
SupprimerBonjour, Nadine.
SupprimerMerci de votre classement ! Et d'accord avec vous : “Le classement est forcément lié au contexte [...] ce qui est F pour l’un peut être E pour l’autre”. Vous avez adopté le terme généraliste “choses” comme étant le plus neutre et le plus large, il me semble.
Et pourtant... Voici une question, juste pour vous taquiner : Dieu est-il “une chose” ?
Pour les uns, c'est une croyance ou une illusion (E ou F), pour d'autres une personne, ou trois personnes (D ?), pour d'autres encore c'est la seule réalité (A+B+C) et c'est vous et moi, qui sommes des illusions. Et essayer de leur démontrer qu'ils se trompent, c'est mission impossible. En bon matérialiste, je me classe dans la première catégorie (les non-croyants) non pas parce que j'aurais là-dessus une preuve directe quelconque, mais indirectement parce que je constate que le cléricalisme et l'idéalisme nourrissent surtout l'oppression.
Il me semble que c'est le comportement et les actes des personnes et des groupes, davantage que ce qu'ils croient (ou croient croire) (ou ce qu'on croit qu'ils croient), qui sont importants. Et donc que l'opposition entre des ressources et des motivations qui seraient imaginaires ou réelles n'est pas si évidente.
Or, justement, “le contexte” dont vous parlez est souvent posé comme évident. Implicitement, l'exemple de Christophe (le paysan qui se contenterait d'une parcelle imaginaire) se situe dans le cadre des échanges marchands (une terre contre une terre, ou contre des biens), où en effet ce paysan serait très naïf. Mais dans la réalité, il n'a jamais manqué de gens pas particulièrement naïfs, qui ont pourtant donné leurs biens et même leur vie pour des choses parfaitement imaginaires comme la liberté, la démocratie, le bonheur de générations qu'ils ne verraient pas.
Nous voilà repartis pour un tour. « MG, c'est plus fort que toi ! ». Trois choses :
Supprimer1. Dire qu'on choisit l'option matérialiste parce qu'on « constate que le cléricalisme et l'idéalisme nourrissent surtout l'oppression » est à mon avis un argument très faible. Si l'idéalisme avait raison, il faudrait accepter ce fait indépendamment de ses conséquences jugées fâcheuses (et au passage, c'est là où le matérialisme de MG, certes revendiqué, ne me paraît pas reposer sur des assises bien solides sur le plan de la méthode).
2. L'exemple de la parcelle imaginaire du paysan n'implique absolument aucune espèce d'échange marchand. C'est MG qui rajoute cette idée, qui n'est absolument pas nécessaire à mon raisonnement.
3. Oui, on peut donner sa vie pour une idée. Mais penser qu'il s'agit de la même chose qu'une croyance où, par exemple, on pense que manger une hostie vous fait partager quelque chose du corps d'un personnage imaginaire, c'est une fois de plus tout mélanger et, par conséquent, s'interdire de rien comprendre.
Et si on arrêtait ?
Je ne vois pas par quelle "méthode" on pourrait démontrer ou prouver que le matérialisme ou l'idéalisme l'emporte. C'est forcément une conviction.
Supprimer... OK, on arrête.
M.G.
Au vu de sa polysémie, je dirais que Dieu est un contexte.
SupprimerChuuuuuut... :-)
SupprimerEst-ce que cette bataille a réellement existé? https://www.youtube.com/watch?v=JI4uirwxx1Y
RépondreSupprimerAbsolument. Nous avions d'ailleurs échangé rapidement à ce sujet : https://www.lahuttedesclasses.net/2022/05/embrouillaminis-chez-les-dugum-dani.html
Supprimeroh! merci! Y en a qu'on plus de mémoire que moi! ;-)
SupprimerCela promet d’être très intéressant. Cette méthode d’un grand matérialisme anthropologique est ce qui manque aujourd’hui dans certains cercles militants, qui, au hasard, peuvent vous sortir de but en blanc que selon Saint-Engels, l’oppression des femmes apparaît comme par magie avec la sédentarisation et la naissance de sociétés de classe (peu importe ce que l’on entend par là) ! Ou carrément qu’il n’existe tout simplement pas de preuves d’une domination masculine « avant le néolithique » !
RépondreSupprimerJe crois que vous vous trompez de reproche. Le problème avec le raisonnement d'Engels n'est pas d'être idéaliste (l'élément déterminant est l'accumulation de richesses entre les mains masculines), mais d'avoir été démenti par les faits. Les cercles militants dont vous parlez (et je pense les connaître assez bien) sont donc beaucoup moins idéalistes que dogmatiques, convaincus qu'ils sont qu'admettre l'ancienneté de la domination masculine, c'est ipso facto tourner le dos au marxisme (et au passage, si la validité du marxisme dépendait réellement des rapports de sexe au Paléolithique, il aurait tout de même les genoux bien fragiles).
SupprimerC’est vrai, Engels et Morgan ne sont pas idéalistes mais ont surtout été en grande partie invalidés par l’évolution des connaissances en ce domaine. Le souci est donc précisément de les considérer comme l’alpha et l’oméga de la réflexion sur le sujet, en ignorant entre autres l’apport du féminisme matérialiste (je pense surtout à Tabet). Le problème est alors d’en inférer des conclusions stratégiques, puisque ce dogmatisme pousse à considérer la lutte pour l’émancipation des femmes comme inhérente à l’apparition des classes, et donc du capitalisme (eh oui, au néolithique ?). Ces considérations sont relativement inintéressantes, et constituent en soi une espèce de lecture fonctionnaliste, voire téléologique, qui aurait pour but de rentrer dans le moule de la lutte des classes (et donc du nécessaire dépassement du capitalisme…)
SupprimerJe dois bien avouer que je ne comprends pas tout ce que vous dites... et sur ce que je crois en comprendre, je ne suis pas vraiment d'accord. Mais comme j'ai déjà écrit cent fois sur ces questions, je ne suis pas certain qu'une cent-unième sera utile !
SupprimerQu’est-ce que vous ne comprenez pas ?
SupprimerSujet intéressant... comment la gauche communiste (on peut inclure, je crois la gauche internationaliste, le trotskysme et aussi un peu les anarchistes) traite l’oppression des femmes?
SupprimerCela va de la secondarisation de la lutte des femmes, en passant par le « ce n’est pas une lutte de classe (interclassiste) à comme vous dites : tout sera réglé sous le communisme ou pire, une espèce d’opportunisme en promulguant la lutte des femmes au-dessus ou en dehors des classes sociales (le patriarcat).
Revenons à Engels :
1- Engels a un réel respect de la science, de son développement (réf Dialectique de la nature) et il serait abasourdi de ce que la gauche communiste en fait aujourd’hui.
2- Sur l’oppression des femmes, il a l’honneur d’y tenter d’y mettre une date (ou une époque) celui de la monogamie comme son affirmation célèbre, ce fut la grande défaite des femmes.
3- Ce que la science aujourd’hui, a découvert c’est que l’oppression commence avant la monogamie et Engels serait surement d’accord avec ça! La monogamie ne vient que couronner cette oppression ou la structurer?
4- Ce que j’observe c’est que on discute du sujet « femmes » alors qu’on devrait discuter de l’objet « reproduction ». En cela, toujours à partir de l’orientation qu’Engels en a donné :
D'après la conception matérialiste de l'histoire, le facteur déterminant dans l'histoire est, en dernière instance, la production et la reproduction de la vie réelle. Ni Marx, ni moi n'avons jamais affirmé davantage.
5- Ça veut dire quoi? On connait très bien l’évolution de la production, mais qu’en est-il de l’évolution de la reproduction? Suivre cette ligne nous évite, je crois de nous enfarger dans les différentes idéologies bonnes ou mauvaises.
C’est le sujet de mon manuscrit....par le biais de : l’histoire et la préhistoire de la division sexuelle du travail.
Et sinon, au cas où, je rappelle que le sujet du billet est mon prochain bouquin, sur la typologie et l'évolution des confrontations collectives. Je dis ça, moi, je dis rien, hein...
Supprimerbien sûr! héhé...désolé d'avoir bifurquer sur autre chose!
SupprimerBonjour je viens de voir votre vidéo avec nota bene et je me demandais si il existe des traces de fortifications ou du moins de défense avec des peuples de chasseurs- cueilleur ?
RépondreSupprimerEn fait, pour les défenses et les fortifications, la bonne question n'est pas « chasseurs-cueilleurs ou cultivateurs », mais « mobiles ou (semi-) sédentaires ». Donc, chez les peuples mobiles, les défenses sont... mobiles : boucliers, armures en os ou en végétaux. Et chez les peuples plus sédentaires, on a des palissades, des fossés, des maisons fortifiées. La question qu'on peut se poser pour les mobiles, c'est l'utilisation volontaire de fortifications naturelles : pas impossible, par exemple, que certains sites d'habitat paléolithiques difficiles d'accès aient été choisis parce qu'ils offraient une protection contre les attaques.
SupprimerMerci pour votre réponse
RépondreSupprimerA-t-on des lieues de vie transformer pour les mobiles ?
C'est à dire ? Des lieux de campements où le paysage a été aménagé de manière durable ? Plus la mobilité est grande, moins c'est le cas... Il faut que les gens reviennent régulièrement et restent un certain temps pour envisager des travaux requérant un investissement plus lourd (ne serait-ce que des maisons en bois – qu'il est très difficile de retrouver en archéologie – ou en pierre).
SupprimerJe signale dans la veine de ce sujet une conférence au Collège de France de Hugo Meijer, invité par Jean-Jacques Hublin : "Aux origines de la guerre et de la paix dans l'espère humaine" : https://www.college-de-france.fr/fr/agenda/conferencier-invite/hugo-meijer/aux-origines-de-la-guerre-et-de-la-paix-dans-espece-humaine (aussi en podcast sur l'appli radio france).
RépondreSupprimerC'est plus précisément : une recherche des origines des comportements létaux et des comportements coopératifs, avec une démarche comme Lahire qui utilise la biologie, l'éthologie, etc. C'est passionnant, très pédagogique, et avec une hypothèse de fin qui a l'air fort logique.
L'anonyme a encore frappé... je suis Nadine.
RépondreSupprimerJe suis en contact avec Hugo, et nous avons pas mal échangé autour de cela. Je n'ai pas lu son manuscrit, mais il s'agit de manière évidente d'un travail très sérieux et marqué par un souci constant de ne pas commettre d'erreur. Seul bémol, il est en anglais, il est épais, et pour l'instant pas de version française et/ou vulgarisée en vue, hélas.
Supprimer