Nouvelle proposition sur les degrés de conflictualité
1. L'état des lieux
Depuis plusieurs mois, ce blog est occupé – certains diront : obsédé – par la volonté d'aboutir à une classification convenable des modalités de la violence collective (dont, bien sûr, la guerre). Les abondantes discussions n'ayant pour le moment pas épuisé le sujet, je reviens aujourd'hui une fois encore à la charge en proposant une nouvelle piste.
 |
| Les Tupinamba représentés par T. de Bry dans une des premières éditions du récit de Hans Staden |
Pour commencer, il n'est pas inutile de rappeler que les difficultés sur le sujet tiennent, notamment, au fait qu'il touche à différentes dimensions que l'on a tendance à mélanger. Si l'on évoque, pêle-mêle, des termes tels que bataille régulée, feud, guerre, raid, razzia, etc. on mobilise (en les télescopant) différents aspects que l'analyse doit au contraire soigneusement distinguer :
- celui de la forme des opérations militaires : une bataille rangée ou non, un coup de main, une embuscade, un assassinat ciblé, etc.
- celui d'un état général des relations : ni le feud, ni la guerre ne sont des événements. Ce sont des rapports entre collectivités qui ouvrent la possibilité de recourir à certains types d'actions. Pour le feud, la gamme de ces actions est a priori assez étroite : il s'agit d'une série d'assassinats et de contre-assassinats de compensation. Pour la guerre, elle est au contraire très large, puisque par définition, l'idée de guerre sous-entend que tous les coups sont permis, qu'il s'agisse d'opérations étroites et ciblées (meurtre, sabotage...) ou d'affrontements beaucoup plus larges (batailles, sièges...).
- celui des motivations à l'œuvre. Le terme de feud ne s'applique que dans les cas où la raison des assassinats concerne la vengeance (ou, ce qui revient au même, la compensation). Celui de guerre, là encore, est générique : il peut exister des guerres pour des motifs très variés, dont la vengeance.
Pour peu qu'on ait de surcroît considéré que l'opposition entre feud et guerre tenait à la nature des unités sociales impliquées (« politiques » ou « non politiques »), celle-ci s'invite comme une dimension supplémentaire, portant le total à quatre. Sur une telle base, il ne faut donc pas être surpris d'être confronté à des difficultés insolubles lorsqu'on cherche à constituer un tableau synthétique.
2. Une nouvelle proposition
Des quatre dimensions évoquées, la proposition qui suit n'en conserve que deux, l'une à titre principal (le niveau de conflictualité), l'autre à titre secondaire (le motif du conflit). On écarte donc résolument comme critère de classification d'une part la forme militaire des confrontations, d'autre part la nature des unités sociales en conflit.
Depuis le début de cette discussion, on tourne autour de l'idée que les situations conflictuelles se déploient à deux niveaux : l'un qui serait en quelque sorte illimité (la guerre), l'autre qui poserait un certain nombre de bornes à l'exercice de la violence ou aux objectifs poursuivis. J'avais ainsi retrouvé à peu de choses près la distinction proposée par Alain Testart entre les guerres stricto sensu et les « engagements à finalité limitée », parmi lesquels le feud, la razzia, et possiblement, la chasse aux têtes.
Je voudrais suggérer ici que cette distinction, si elle a quelque chose de juste, n'est pas complètement opérante, et qu'on cernerait mieux la réalité en reconnaissant non deux, mais trois niveaux de conflictualité. Ces trois niveaux résultent du croisement de deux variables :
- Le conflit suppose-t-il, ou légitime-t-il, un nombre prédéterminé d'homicides ? Autrement dit, dans le cadre de ce conflit, envisage-t-on de tuer une quantité spécifique d'adversaires, ou cette quantité est-elle a priori sans limites ?
- Le conflit a-t-il pour objectif de modifier durablement la situation, ou le rapport de forces, entre les collectivités impliquées ? En d'autres termes, s'agit-il pour l'un au moins des belligérants de remporter une victoire, c'est-à-dire d'affaiblir l'ennemi – ou point, éventuellement, de l'annihiler ?
On voit d'emblée que ces deux critères binaires dessinent trois configurations et non quatre : il n'est pas possible de chercher à remporter une victoire sur une autre collectivité (autrement dit, de la soumettre et de lui imposer sa volonté) en limitant a priori le nombre d'homicides que l'on est disposé à commettre. On obtient donc la gradation suivante :
| Degré de conflictualité | 1 | 2 | 3 |
| Limitation a priori du nombre d'homicides | Oui | Non | Non |
| Volonté de vaincre / soumettre / modifier durablement le rapport de forces, etc. | Non | Non | Oui |
Comme on le disait précédemment, cette approche peut être ensuite déclinée selon les motifs de conflits. Si l'on commence par le motif emblématique de la vengeance, on reconnaît immédiatement dans le degré de conflictualité 1 le cas du feud, autrement, celui qui verra se dérouler un certain nombre d'assassinats de compensation non consentis (et donnant donc lieu à une rétorision ou, tout au moins, à la volonté d'une rétorsion future). On identifie également dans le degré 3 la guerre vindicatoire, où l'on tue sans compter, en cherchant à « donner une bonne leçon », voire une leçon définitive. Mais cette tripartition permet également de dégager une situation intermédiaire, celle où l'on a en quelque sorte cessé de tenir les comptes, où l'on tue dès que l'occasion s'en présente parce que ce sont des ennemis traditionnels, mais sans pour autant chercher à les éliminer ou à les réduire à l'impuissance.
3. Quelques cas ethnographiques
Cette situation peut-elle être identifiée dans le matériel ethnographique ? Je suis prêt à parier que si je reprenais mes données australiennes, j'en trouverais certaines pour lesquelles, à tout le moins, le doute est permis. Je pense en particulier à cet épisode rapporté par Howitt (événement 61 de ma base de données), où un groupe de Kurnai avise un campement de « Brajerak » (terme dégradant désignant toute tribu ennemie) et en massacre les occupants, sans qu'on ait le sentiment que cette action s'inscrive dans une volonté plus globale d'éliminer lesdits Brajeraks, ou même de les réduire à sa merci. Quoi qu'il en soit, on trouve sur d'autres continents certains éléments qui plaident en faveur de l'existence de cette configuration.
Voici par exemple ce qu'écrit Adriana Sterpin à propos des Chaqueňos, un peuple du Chaco (les soulignés sont les miens) :
Bien que qualifiées parfois de « feuding » ou « vendetta » (Karsten, 1932 : 102-103 ; Fock, 1963), les guerres des Indiens chaqueňos — comme d'autres guerres sudamérindiennes (...) ne semblent pourtant pas avoir obéi à une logique vindicatoire, selon la définition anthropologique moderne du terme (cf. Verdier, 1980). En particulier, les échanges de violences ne sont pas ici régis par une règle de réciprocité dans un jeu de « somme zéro ». Au contraire, et comme la vengeance Tupinamba ou la guerre inter-tribale jivaro, le caatshai n'a ni début ni fin ; il est, par définition, interminable : il y a toujours une perte à venger, et cette vengeance est anonyme. Certes, les captifs peuvent être restitués, mais une mort subie en guerre (les Nivacle diraient même une blessure) non seulement ne peut pas être abolie par des compensations adéquates (chevaux, fusils, comme c'est le cas de l'homicide) mais elle ne peut même pas être effacée par une (ou plusieurs) morts infligées : vis-à-vis des ennemis, on n'est jamais, on ne peut pas être quittes. (A. Sterpin, « La chasse aux scalps chez les Nivacle du Gran Chaco », Journal de la Société des Américanistes, tome 79, 1993. p. 58)
On retrouve en effet ce thème, exprimé de diverses façons, sous la plume d'autres amazonistes. En particulier, Un article de M. Carneiro da Cunha et E. Viveiros de Castro (« Vingança e temporalidade: os Tupinamba », Journal de la société des américanistes, Année 1985, n°71), cité par Sterpin, donne une image tout à fait similaire de la guerre (mais faut-il vraiment l'appeler ainsi ?) des Tupinamba.
Pour commencer, celle-ci se formule et se pense entièrement en termes de vengeance. On ne combat ni pour conquérir des terres, ni pour piller des biens, ni même pour épouser des femmes. Quant aux prisonniers, on n'en fait aucune utilisation économique ou politique. Comme le rapportait déjà le fameux témoignage de Hans Staden, au milieu du XVIe siècle, on conservait le prisonnier durant des semaines, voire des mois, avant de l'exécuter d'un coup d'épée gourdin sur le crâne, lors d'une cérémonie hautement ritualisée. Tout aussi codifié était le banquet qui s'ensuivait, au cours duquel la victime était rôtie et mangée par l'ensemble du village et de ses invités.
 |
| Le banquet anthropophage des Tupinamba |
Ainsi qu'on le disait, ces conflits étaient entièrement conçus comme l'exécution d'une vengeance. Mais, de même que chez les Chaqueňos du Chaco, cette vengeance ne peut être comprise de façon satisfaisante ni en termes de feud, ni en termes de guerre. Il ne s'agissait pas d'équilibrer des pertes, et de solder des dettes de sang : si toute capture et exécution d'ennemis était vue comme une rétorsion pour les meurtres passés (réels ou imaginaires), cette rétorsion était destinée à être sans fin - et à alimenter, en sens inverse, de futures vengeances : très significativement, le prisonnier qui s'apprêtait à être tué tenait un discours convenu, où il déclamait que les siens le vengeraient et se repaîtraient à leur tour de la chair de ses assassins. La vengeance tupinamba est explicitement une « vengeance sans fin » : elle est donc tout à fait différente d'un assassinat de compensation, où l'on aspire à ce que ce geste solde les comptes et mette un terme à la situation d'hostilité. Mais inversement, ce n'est pas d'une guerre au plein sens du terme qu'il s'agit : on ne cherche pas à écraser l'adversaire, à le mettre hors d'état de nuire, voire à l'exterminer. On se satisfait de ces incessants coups de main, qui étonnent même par le faible bénéfice qu'ils apportent au regard des efforts qu'ils nécessitent : « Ces Indiens, qui parcouraient, même plus de 300 miles lorsqu'ils partaient en guerre, se contentaient de quatre ou cinq ennemis capturés, mettant fin à l'expédition. »
Même si cela mériterait vérification, j'ai le sentiment que ce cas de figure se retrouve peu ou prou sous d'autres latitudes. Dans les plaines de l'Amérique du Nord, par exemple, un auteur comme Mishkin (Rank and warfare among Plain Indians, 1940) évoque à propos des Kiowa – hélas, sans trop de précisions – des actions de vengeance menées sur une échelle manifestement beaucoup trop large pour correspondre à un simple meurtre de compensation, sans toutefois dépasser le coup ponctuel qui n'ambitionne pas d'obtenir une victoire durable.
Ce qui précède amène tout droit à une remarque générale, à savoir que la zone centrale de ce schéma, c'est-à-dire le degré 2 de la conflictualité, a pu facilement être selon les cas rattachée au degré 1 (concernant la vengeance, celui du feud proprement dit) ou au degré 3 (celui de la guerre). On peut penser que reconnaître cette zone intermédiaire est un moyen de lever certaines ambiguités et incompréhensions. Il y aurait donc en quelque sorte du feud au sens strict (celui qui relève de la conflictualité de degré 1) et au sens large (qui englobe également le degré 2). De même, le terme de « guerre » peut être compris dans un sens strict, celui de la conflictualité de degré 3, ou lui aussi au sens large en étant étendu à celle de degré 2.
4. Et hors de la vengeance ?
Cette distinction me semble également fonctionner pour des conflits qui ne relèvent pas de la vengeance, mais qui se déploient pour d'autres motifs. Ainsi, trivialement, ceux qui correspondent à la volonté de s'emparer de biens ou de captifs. La classification proposée permet alors de distinguer ce qui n'est qu'un simple coup de main (une opération de razzia) d'une situation de guerre où il s'agit de mettre l'adversaire en coupe réglée. En ce qui concerne ce qu'on appelle faute de mieux la chasse aux têtes, les critères ci-dessus amèneraient à faire une différence entre celle qui vise un seul individu (degré 1) et les raids qui entraîneront la mise à mort de toute une maisonnée ou de tout un village (degré 2) – on peut douter de l'existence d'authentiques guerres (degré 3) liées à ce motif. Mais elle permettrait en tout cas de considérer ce dernier cas de figure comme une catégorie à part entière, sans être obligé de le rabattre de manière forcée vers le feud ou vers la guerre.
Naturellement, la robustesse de ce tryptique devra être éprouvée, entre autres, en le confrontant aux différents types d'opérations identifiées par les peuples eux-mêmes, pour voir dans quelle mesure ceux-ci étaient conçus en fonction de ces trois possibles degrés d'hostilité.
Pour terminer, un premier point est que l'on pourrait tout à fait concevoir une extension de cette classification vers une situation qui serait le contraire de l'hostilité, à savoir celle de l'amitié (autrement dit, de la conflictalité négative). Je ne sais pas s'il conviendrait d'insérer, entre les deux, une zone qui correspondrait à la neutralité. Mais du point de vue de ce que j'appelais à propos de l'Australie le principe de modulation, une telle extension des catégories couvrirait la gamme des relations possibles : à un dommage, on répondrait par un dommage moindre (conflictalité négative), et par un dommage de plus en plus important à mesure qu'on se situe dans un état de conflictualité élevé.
Un second point est celui des batailles judiciaires rangées, décidées d'un commun accord. Celles-ci incluent les batailles régulées, si fréquentes dans les sociétés non étatiques, mais aussi certains affrontements sans merci, tels le gaingar de la Terre d'Arnhem. En soi, de tels événements n'occupent pas une place définie dans la classification que je propose ici. Cette forme exprime en effet le fait que les deux parties s'accordent sur le mode de règlement du différent ; mais en elle-même, elle ne dit rien de la profondeur de ce différend. Voilà pourquoi, dans certains cas, elle s'effectue avec des armes non létales et ne doit déboucher, normalement, que sur de simples blessures, alors que dans d'autres elle peut être si violente qu'on peut la considérer comme une guerre pure et simple.


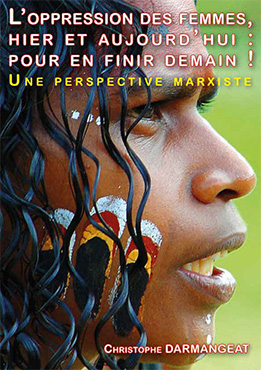

Bonjour,
RépondreSupprimerJe vous lis depuis longtemps avec intérêt. Merci pour votre travail. Sans avoir forcément de remarques pertinentes à faire sur le fond lui-même, j'ai repéré un certain nombre de coquilles dans le texte (sans doute dues à l'enthousiasme provoqué par cette proposition de classification). Si cela vous intéresse :
"l'odée de la guerre sous-entend..."
"la raison des assassinats concere la vengeance"
"la proposition qui suit ne concerve que deux..."
"(terme dégradant désignant toute tribuu ennemie)"
"j'ai le sentiment que ce cas de figure se retrouce peu ou prou..."
"le coup ponctuel qui n'ambitionne pas à une victiore durable..."
"cette distonction me semble..."
"ceux qui à la volonté de s'emparer de biens... (?)"
Au plaisir de vous lire à nouveau,
Ralalala, l'impatience de la jeunesse fait que j'ai tendance à mettre en ligne avant de procéder à une relecture attentive. Merci à vous de votre œil scrutateur !
SupprimerHello,
RépondreSupprimerTu comptes quatre aspects à distinguer (forme, état général des relations, motivations, nature des unités sociales éventuellement) pour n’en retenir que deux : niveau de conflictualité et motif (la forme et la nature des unités sociales étant écartées). Donc, motif = motivation, ça, c’est OK. Mais tu assimiles aussi « état général des relations » et « niveau de conflictualité », alors que pour moi ce n’est pas la même chose. Le premier renvoie à la forme du rapport social entre groupes, le second pas du tout. Il n’est même pas évident que les deux soient fortement corrélés (même si forcément en partie).
En fait, je me demande si le critère niveau/degré de conflictualité, que tu tiens comme premier depuis le début, n’est pas en réalité très secondaire. Je me pose la question depuis un certain temps, mais plus ça va et plus je suis persuadé qu’on n’arrivera à rien de vraiment pertinent en croisant « motivation » et « niveau de conflictualité », que ce soit avec deux ou trois degrés, parce que ce n’est tout simplement pas la bonne base de classification. Je suis convaincu qu’il y a quelque chose de plus profond à trouver, qui tourne effectivement très certainement autour des rapports sociaux entre groupes.
Je n'ai peut-être pas choisi mes qualificatifs avec suffisamment de soin, mais à mes yeux, l'état général des relations et le niveau de conflictualité, c'était effectivement la même idée. Et si tu dis que pour toi, ce n'est pas du tout le cas, alors je ne vois pas quel aspect de la réalité désigne, selon toi, l' « état général des relations ».
SupprimerPour le reste, je vois encore moins comment le degré de conflictualité ne pourrait pas être central dans une classification des types de conflits. Mais là aussi, je ne demande qu'à être convaincu ; mais pour cela, il faudra que tu en dises un peu plus sur ta proposition alternative. Parce qu'en attendant, ma proposition à trois degrés, je trouve qu'elle fonctionne quand même plutôt bien...
Ben, pour moi les relations ce sont les liens entre groupes (c'est un peu la définition...). Je ne vois pas trop le rapport avec le niveau de conflictualité, qui correspond à l'idée que les conflits sont plus ou moins limités. C'est sans doute un problème d'appellation vu de chez toi, mais justement moi j'aurais tendance à croire que les relations entre groupe stricto sensu sont peut-être une piste à suivre.
SupprimerEn ce qui concerne l'importance même du degré de conflictualité pour une classification, je sais que tu en es persuadé depuis le début, mais j'en suis bien moins convaincu que toi. Je n'ai pas vraiment de proposition alternative, en tout cas rien de mûr, mais d'une part je trouve qu'avec les deux mêmes critères depuis le départ, ça tourne quelque peu en rond (et rajouter un degré ne me paraît rien changer). Et d'autre part je ne vois pas trop pourquoi une classification pertinente des types de conflits devrait nécessairement prendre en compte le degré de conflictualité. Peut-être, et après tout c'est ce qui pourrait ressortir in fine, mais je ne crois pas qu'on puisse le décider a priori.
Pardon de m'immiscer, mais la matrice à 2 dimensions de Christophe me semble aussi au premier abord plutôt bien fonctionner. Mais ne pourrait-on pas imaginer, à la suite des mathématiques, de concevoir des matrices à plus de dimensions? Evidemment , impossible à la main, mais les progrès dans la programmation informatique devrait les permettre. Après, le problème est quoi mettre dedans et répartir les items, pondérer ... Serait-ce possible?
RépondreSupprimerVous êtes tout pardonné, le blog est fait pour que chacun puisse s'immiscer ! On peut tout à fait concevoir des classifications à plus de deux dimensions, et c'est d'ailleurs cette solution que j'avais retenue dans mon approche des procédures judiciaires australiennes : https://1.bp.blogspot.com/-fSKZXZdjUmw/XS9q-ubEw1I/AAAAAAAAJ_w/Tnc2d-ULNXkcTGRKbITrHwDmcCSLU2dhwCLcBGAs/s1600/Classification-suppl%25C3%25A9mentaires.jpg
SupprimerAprès, il faut trouver le bon compromis entre une formalisation trop simple et donc, qui rate des dimensions importantes de la réalité, et une formalisation trop lourde qui serait plus précise, mais inutilisable. D'où les incessants tâtonnements auxquels je me livre depuis plusieurs mois pour essayer de trouver la bonne formule...
Tout cela est passionant ! Merci pour ces réflexions
RépondreSupprimerHello,
RépondreSupprimerJe m’immisce à mon tour dans la discussion après avoir épluché la dizaine de billets qui lui sont consacrés et les commentaires qui les accompagnent (il m’aura quand même fallu une journée complète pour rattraper mon retard !!).
Le point sur lequel je souhaitais réagir concerne la définition de la guerre, et l’éventuelle classification des conflits armés qui doit en découler.
Tout comme Christophe, j’ai été très enthousiasmé par la définition proposée par Bruno dans son article de 2020 (que je cite à nouveau pour éviter tout quiproquo) : « État conflictuel entre deux ensembles distincts de personnes (groupes) qui se perçoivent globalement et réciproquement comme ennemis et entretiennent un rapport social d’hostilité, chaque groupe tentant d’établir sa supériorité sur l’autre par le moyen de la lutte armée. »
Effectivement, la nature des unités sociales impliquées n’est pas, de mon point de vue, un critère pertinent, même si je considère (et je pense que c’était l’avis initial de Jürg Helbling – j’espère ne pas déformer sa pensée !) qu’il n’y a pas de guerre sans groupes capables d’agir comme acteurs collectifs vis-à-vis d’autres groupes. Cette définition minimaliste, qui aurait le bénéfice de mettre tout le monde d’accord, pourrait-elle porter l'étiquette d'« unité politique » ? Une « unité politique », lorsqu’elle est en guerre, doit-elle nécessairement être en capacité de contraindre tous les membres du groupe à prendre une part active au conflit ? Les Aborigènes d’Australie, les Indiens des Plaines, les héros de l’Iliade peuvent à tout moment décider de s’extraire d’un affrontement dans lequel ils se sont engagés à titre volontaire. Soit. Il n’en demeure pas moins que la guerre de Troie est la guerre des Achéens contre les Troyens.
Deuxième point, le plus important à mes yeux : le critère de la finalité est-il si important pour définir le phénomène-guerre ? Si je suis bien Bruno, la condition nécessaire pour qu’un conflit soit qualifié de guerre serait la recherche, de la part de la partie qui initie les hostilités, d’une forme de supériorité politique. Ce que Christophe restitue, dans un billet antérieur, de la manière suivante : « Le point crucial est la volonté d'établir sa supériorité. C’est cet élément qui est absent dans les opérations qui relèvent tant du feud que de la chasse aux têtes standard. En d’autres termes, ce sont des combats qu’on ne mène pas pour vaincre l’ennemi, ni même en soi pour l’affaiblir, mais seulement pour effectuer un prélèvement. »
(1/2)
Cet élément de définition me gêne de plus en plus, car il revient en effet à exclure de la discussion certaines « guerres à finalité d’acquisition » (pour reprendre la terminologie testardienne). Prenons l’exemple des expéditions de pillage des Sarmates, des Alains ou encore des Huns contre l’Empire romain. Ces raids ont, le plus souvent, pour unique objectif de faire du butin (e.g. Tacite, Hist. 1.79 : praedae intenta [à propos des Sarmates Rhoxolans qui pillent la Mésie en 69]). Il ne s’agit pas d’occuper un territoire voisin, ni même de détruire l’outil militaire adverse. Dès lors qu’on peut éviter les pertes, en agissant furtivement, c’est tant mieux : on rentre chez soi chargés d’or, de bétail et d’esclaves !
RépondreSupprimerPourtant, ces attaques – qui peuvent impliquer plus d’une dizaine de milliers de cavaliers déployés en unités disciplinées – débouchent régulièrement sur des batailles rangées très meurtrières (c’est le cas en 69 : les Sarmates sont rattrapés par l’armée romaine, alors qu’ils s’apprêtent à repasser le Danube, et sont vaincus en rase campagne) et même, à partir de l’irruption des Huns en Europe, sur des opérations de siège. Pourquoi ? Parce que ces peuples de nomades cavaliers sont disposés à recourir à la violence sans restriction pour réaliser leur objectif, et qu’il en va de même de l’armée romaine, dont la mission est de protéger les populations de l’Empire.
Dans tous les cas, on conviendra que le fond de l’affaire n’est pas la recherche de la supériorité politique. Et pourtant, qui nierait que ces affrontements sont de véritables « guerres », alors que les anciens eux-mêmes les qualifient régulièrement de bellum ou de polemos ?
Le même problème se pose chez Testart, autour de la notion d’engagement à finalité limitée qu’il développe dans son manuscrit inédit sur le politique. Selon lui, c’est le caractère limitatif de leur objectif (acquérir certains biens, tuer des individus déterminés) qui caractérisent ces « engagements » et les distingue des « guerres » proprement dites. Il y a là, je pense, une mauvaise piste. C’est plus la limitation des violences qui doit servir de critère, car une opération de pillage peut très bien être formellement une guerre, ce que montrent les exemples évoqués plus haut.
Bref, tout ça m’amène à penser que la proposition de Christophe autour des degrés de conflictualité est peut-être la plus pertinente… avec une petite nuance de mon côté : lui semble considérer que la guerre proprement dite commence au 3e degré (pas de limitation du nombre d’homicide + volonté de soumettre), alors que j’aurais plutôt tendance à la faire démarrer au 2e degré, catégorie dans laquelle j’insère mes exemples de guerre de pillage.
De ces éléments de réflexion, je propose la définition suivante de la guerre :
- La guerre est un affrontement armé et meurtrier, opposant aux moins deux communautés qui ont pour caractéristique fondamentale d’agir en tant qu’acteurs collectifs vis-à-vis d’autres groupes.
- Les communautés qui participent à cet affrontement mettent explicitement leurs buts de guerre au service d’une finalité collective, qui peut varier selon les cas de figure.
- Afin d’atteindre cette finalité ou d’empêcher que la communauté ennemie ne parvienne à imposer la sienne, les deux partis s’autorisent à tuer indistinctement et sans restriction, jusqu’à ce que l’objectif soit atteint, abandonné ou redéfini.
Voilà ! Je m’excuse par avance pour cette réaction un peu longue. N’hésitez pas à me dire si j’ai déformé vos propos, et à critiquer le contenu de ma définition. Elle me sert pour l’instant de base de travail, mais je ne doute pas qu’on puisse l’améliorer !
Maxime
(2/2)
Bonjour Maxime,
SupprimerJe réponds assez rapidement, car en ce moment le dossier « guerre » prend la poussière étant donné que je suis accaparé par d’autres choses. Mais il faudra que je me repenche sur ton très intéressant commentaire.
En ce qui concerne la définition que j’ai donnée, je me suis justement bien gardé d’accoler un qualificatif à « supériorité », et surtout pas celui de politique, de manière à conserver un sens large. Il ne s’agit donc pas de supériorité politique, mais de supériorité sur l’adversaire lato sensu. On pourrait remplacer « établir sa supériorité sur l’autre » par « dominer l’autre » pris dans le même sens.
Sinon, en vrac :
– Je suis d’accord sur la question que le groupe doit être capable d’agir comme acteurs collectifs vis-à-vis d’autres groupes. Pour moi, c’est un critère en partie contenu dans l’appellation même de « groupe », puisqu’au sens social c’est un ensemble de personnes ayant des caractères et/ou des intérêts communs. Mais effectivement ce n’est peut-être pas si clair que ça pour tout le monde et il faudrait peut-être rajouter la précision.
Par contre, je ne vois pas que l’on puisse dans tous les cas appeler ça une « unité politique » : c’est parfois vrai, mais sûrement pas tout le temps (pas pour les Aborigènes et les Indiens des Plaines que tu cites, et pour la guerre de Troie ça m’étonnerait que l’on puisse parler d’unité politique pour les Achéens, qui ne sont qu’un assemblage de plusieurs cités-États — déjà, Ménélas est roi de Sparte et Agamemnon est roi de Mycènes…). De tout façon, il faudrait déjà que tout le monde soit d’accord sur la définition d’une « unité politique », et là bon courage. À mon avis, non seulement le terme « politique » est inutile dans une définition de la guerre, mais en plus il est source de problèmes.
– Sur la finalité, il faut donc complètement sortir « politique » de la réflexion. À partir de là, je reste convaincu qu’un des critères de définition de la guerre est bien la finalité d’établir sa supériorité sur l’adversaire (= lui mettre une raclée), d’autant que, comme le soulignait Christophe, ça sépare bien la guerre de ce qui n’en est pas (au moins jusqu’à preuve du contraire, selon la formule consacrée).
Néanmoins, tu soulèves la juste question de la frontière entre pillage et guerre dans les cas que tu évoques. Comme ça, sans plus creuser pour l’instant, je pense qu’un élément de réponse se trouve dans le fait que la guerre est un état et que le pillage est une opération. En passant, que la guerre soit un état me paraît fondamental et même si Christophe n’est pas de cet avis, je crois que c’est un critère premier pour une classification. Mais pour en revenir à la distinction, je pense qu’on peut tout à fait distinguer deux niveaux : celui de la guerre entre Romains et Sarmates, Huns ou autres (qui sont des groupes ennemis), avec parfois des bastons, et celui des opérations (raids) de pillage, où le but n’est effectivement pas d’établir sa supériorité sur l’autre. Mais il faudrait sans doute réfléchir plus, d’autant que ce n’est pas le coin et l’époque que je connais le mieux. Il faudrait qu’on trouve l’occasion d’en discuter un jour (le blog a aussi ses limites).
– Du coup pour la définition que tu proposes :
Pour l’item 1 : du moment que la guerre est un état, de mon point de vue, je ne crois pas qu’on puisse la limiter à un affrontement ;
Pour l’item 2 : si par finalité collective, tu entends qu’elle est la même pour tous les participants, je n’y crois pas (pour rester à Troie, Ménélas veut se venger de l’enlèvement d’Hélène, pas Achille ou Ulysse, qui participent à la guerre pour des raisons obscures et contradictoires selon les sources, mais dont on peut penser qu’ils sont plus intéressés par le butin à gagner dans l’affaire ; après, s’il faut vraiment trouver une finalité collective, je n’en vois justement pas d’autres que dominer/établir sa supériorité).
Allez, j'y vais vite fait de mon grain de sel : je pense que Maxime met le doigt sur une situation objectivement embêtante (donc intéressante !). Plus ça va, plus je crois qu'un des fonds du problème, c'est ce terme de « guerre » qui est aussi gênant qu'il est utile, parce qu'il nous empêche en partie de trouver les bons critères pour raisonner. Si j'osais un parallèle, je dirais bien qu'il en va de la même manière que les noms d'animaux vernaculaires, qui souvent regroupent des espèces assez éloignées tout en écartant d'autres espèces proches. Résultat, la bonne question c'est beaucoup moins de distinguer la guerre de la non-guerre (ou de la guerre-autrement), que de trouver les bons critères pour ranger tous ces phénomènes de manière pertinente.
SupprimerSinon, je suis d'accord pour dire que les états et les opérations ne relèvent pas du même niveau, et qu'une classification se doit d'éviter de tout mélanger. Plus le temps passe, plus il me semble que le bon point d'entrée est celui des opérations et de leurs finalités. Mais là aussi, dans les finalités, il y a des niveaux à distinguer, et le terme introduit lui aussi de la confusion : on peut se battre pour vaincre (dominer / établir sa supériorité) ET pour piller, ou se venger : et quand on parle de finalités, on a tendance à mélanger les finalités les plus générales et celles qui sont plus particulières. Globalement, je pense qu'on ne peut pas s'en sortir si on ne met pas d'emblée sur la table toutes les formes de confrontations physiques, et pas seulement l'opposition restreinte (et non saturante) entre le feud et la guerre.
Bref, j'ai une idée en stock, mais j'ai envie de la fourbir avant de la dégainer !
;-)