Des paiements en Australie ?
Les lecteurs d'Alain Testart (et les familiers de ce blog) savent que ce dernier considérait que les sociétés primitives (sans classes et/ou sans État) se partageaient fondamentalement en deux ensembles (le « monde I » et le « monde II ») : celui des sociétés sans richesse, dans lequel on ne peut se libérer d'une obligation sociale (liée, en particulier, aux mariages ou à la compensation des meurtres) en versant des biens ; et celui des sociétés à richesse, où ce versement devient possible, sinon obligatoire. Alain Testart tenait cette distinction pour si essentielle qu'il pensait que l'opposition entre monde I et monde II était plus radicale encore que celle entre sociétés primitives et sociétés de classes.
Pour autant, il est bien évident que le basculement du monde I au monde II n'a pu se faire de manière instantanée. Il a nécessairement existé des formes transitoires, si fugaces aient-elles pu être. C'est l'une de ces formes, et l'un de ces modes de transition, qu'a explorés Pierre Lemonnier dans un article aussi court que lumineux à propos des Baruya – égratignant, par la même occasion, les étranges conceptions d'un Pierre Clastres sur l'évolution sociale.
Selon Alain Testart, l'Australie occupait une place particulière au sein du monde I : tout entière marquée par des obligations à vie, elle représentait la forme censée être la plus éloignée du monde II et donc la moins susceptible d'évoluer dans sa direction. Il est donc d'autant plus intéressant d'y relever les quelques occurrences qui y montrent l'existence incontestable de paiements : celles-ci fournissent sans doute des indices précieux sur les voies d'une éventuelle transition des formes australiennes vers la richesse.
Le prix de la fiancée chez les Warlbiri
 |
| Mervyn Meggitt avec trois Aborigènes, en 1953 |
Le premier cas est celui des Warlbiri, un peuple du désert occidental, sur lequel on dispose en particulier de l'ethnographie de Mervyn Meggitt, Desert People, réalisée dans les années 1950. Meggitt indique quelles sont les voies par lesquelles les hommes peuvent parvenir à se procurer une épouse :
- Le lévirat, c'est-à-dire la coutume consistant à ce qu'à la mort d'un homme, ses femmes soient transférées à l'un de ses frères ou à plusieurs. Chez les Warlbiri, les frères réels pouvaient refuser cet héritage ; les veuves étaient alors affectées à des frères classificatoires, généralement des célibataires sans perspective matrimoniale. Cependant, Meggitt indique que pour les hommes qui en bénéficiaient, cette attribution était rarement satisfaisante : les seules femmes ainsi distribuées étaient les plus âgées, dont personne ne voulait.
- La circoncision. C'était la voie normale et, si l'on peut dire, royale : tout homme devait être circoncis et tout circonciseur, devenant ipso facto son beau-père, devait une femme à celui qu'il avait opéré. La plupart des femmes (mais pas toutes) étaient ainsi promises longtemps à l'avance dans des arrangements conclus entre les familles des jeunes garçons et ceux qui les initiaient.
- Il arrivait qu'une jeune fille non promise fasse l'objet d'une négociation privée entre ses parents et le prétendant. Selon Meggitt cette situation était peu fréquente.
Dans le passé, le prix de la fiancée incluait des articles tels que de la viande cuite (en particulier, de kangourou et d'émeu), des morceaux d'ocre rouge, des cordes de cheveux, des boomerangs, des lances de chasse et de combat, des propulseurs et des boucliers.(p. 267)
Dans les années cinquante, lorsque cette ethnographie fut réalisée, ces biens avaient été remplacés, au moins en partie, par des vêtements, des couvertures et de l'argent.
Indice supplémentaire que les biens versés représentaient un effort réel, on les conservait de génération en génération afin de financer les mariages des enfants masculins : le père redonnait une partie du prix de la fiancée qu'il avait reçue pour marier ses fils adultes. Ajoutons que ces paiements n'étaient pas compensés, comme c'est parfois le cas, par un retour équivalent : le seul versement en sens inverse était effectué par la mère de la promise sous forme d'une livraison de nourriture végétale cuite à la famille du fiancé.
Sous la plume de Meggitt, le versement effectué lors des fiançailles apparaît de loin comme la principale prestation matrimoniale. Le mari se contente, par la suite, de faire des « cadeaux occasionnels de viande » aux parents de sa femme lorsqu'il lui rendent visite. On aimerait évidemment savoir si ces cadeaux en étaient réellement, et si Meggitt n'a pas qualifié de « cadeaux » ce qui était, comme dans d'autres tribus australiennes, une obligation stricte de fournir à sa belle-famille certaines parties prédéfinies du gibier abattu. Mais si on peut se poser la question, on ne peut y répondre et, faute d'informations supplémentaires, rien n'interdit de penser quer Meggitt est près de la vérité et que chez les Warlbiri, le poids du prix de la fiancée avait rendu les prestations viagères d'autant plus légères et d'autant moins contraignantes.
Une peine de substitution chez les Alawa
Les Alawa sont une tribu du sud-est de la Terre d'Arnhem, sur laquelle nous sommes renseignés par l'incroyable autobiographie de Waipuldanya, un Aborigène qui, tout en conservant un contact permanent avec sa tribu, reçut une éducation occidentale et exerça diverses fonctions chez les Blancs. Douglas Lockwood recueillit son récit et le publia en 1962 sous le titre I, the Aboriginal.
Waipuldanya décrit avec force détail le pouvoir des anciens qui occupaient les plus hautes fonctions cérémonielles (les grands Djungayi), et la possibilité qu'ils avaient de décréter la mort de quiconque était supposé avoir commis une grave faute à caractère rituel... ou de lui appliquer une peine de substitution :
Mes pouvoirs de Grand Djungayi s'étendaient bien au-delà du contrôle des initiés et des coutumes cérémonielles. En fait, j'étais investi du droit d'ordonner l'exécution d'un traitre au Kunapipi [la cérémonie la plus secrète et la plus importante], ou de lui laisser la vie sauve moyennant le paiement d'une lourde amende.
Il poursuit en montrant comment cette latitude se heurtait à des limites assez étroites :
Les Djungayi inférieurs, mes conseillers, pouvaient dire : 'Cet homme a volé une peinture Kunapipi. Cet homme a dévoilé le secret à une femme. Nous voulons qu'il meure.'Je pouvais alors donner le signe de l'exécution, le condamnant à la mort, ou le laisser en vie contre une amende et une promesse. En pareil cas, le Grand Djungayi subit généralement une forte pression en faveur de la peine de mort de la part des accusateurs outragés. S'il refuse trop souvent, il peut y avoir un mouvement afin de le remplacer. » (p. 104)
On regrette alors qu'il ne donne pas davantage de détails, que ce soit sur le(s) destinataire(s) de cette amende ou sur sa composition. Sur ce dernier point, on peut néanmoins en avoir une petite idée au travers de ce que Waipuldanya raconte de violents jeux d'enfants, où ceux-ci singent les adultes. Les simples plaies et bosses étaient vite oubliés.
Mais si quelqu'un était sérieusement esquinté, nous adoptions le système de compensation des anciens. Au repas, le garçon blessé avait droit à un gâteau ou un plat de riz appartenant à son agresseur. Cela signifie que l'un se remplissait la panse tandis que l'autre restait le ventre vide. Si la blessure était particulièrement sévère et manifestement délibérée, le coupable était délesté d'un objet auquel il accordait de la valeur, comme par exemple une lance à poissons fabriquée pour lui par son père. (p. 50)
Quelques remarques pour finir
Même si les informations restent parcellaires, il semble néanmoins que :
- Dans les deux cas, le paiement en biens existe comme mode secondaire : c'est soit un substitut, soit un complément au mode principal. Chez les Warlbiri, même s'il revêt un caractère obligatoire pour tout mariage en-dehors du lévirat, il n'a pas pris, en quelque sorte, sa pleine autonomie : on se marie bien davantage via la circoncision que par un paiement simple – même si, dans les deux cas, le paiement est obligatoire. Chez les Alawa, le paiement est clairement un substitut à la peine de mort, et est caractérisé comme tel par cette société elle-même. On retrouve une configuration similaire chez les Baruya, ainsi que le souligne le texte de Pierre Lemonnier déjà cité ; le prix de la fiancée n'était versé qu'à titre compensatoire lorsque, suite à la stérilité d'une épouse, l'échange matrimonial des sœurs apparaissait après coup comme inéquitable : il fallait alors rétablir la balance. Le raisonnement comme les faits militent donc en faveur de l'idée intuitive que les paiements en biens sont partout nés dans les marges des pratiques dominantes, à titre accessoire, avant de devenir le mode principal sous l'effet d'un certain nombre de mécanismes qui demanderaient à être étudiés en détail.
- Les biens impliqués sont au départ des biens ordinaires, même si les quantités demandées peuvent exiger un réel effort de la part de celui qui les fournit. Il est toutefois plus difficile de généraliser cette observation ; on ne voit pas pourquoi il devrait nécessairement en être ainsi, et ce qui empêcherait les paiements d'impliquer directement des biens de prestiges (par exemple importés et rares).



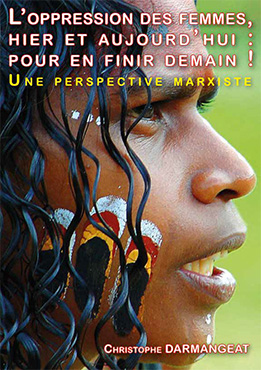

Aucun commentaire