Lafitau et la « petite guerre » iroquoise

Avec un peu de naïveté, on pourrait se dire que plus un peuple ou une société sont documentés, plus le consensus à son sujet est établi, et moins nombreuses sont les polémiques pour la caractériser. Il suffit de penser à ce qu’il en est de notre propre société, pourtant connue par des millions de travaux et de données, pour savoir à quoi s’en tenir. On ne s’étonnera donc pas qu’en ethnologie, les discussions (et les polémiques) soient d’autant plus nourries que le cas est bien connu.
C’est ce qui arrive avec les Iroquois, ces Amérindiens de la région de Grands Lacs, au contact des Blancs dès le XVIe siècle, célèbres pour la place a priori étonnante qu’y occupaient les femmes ainsi que pour leurs pratiques guerrières. Celles-ci, qui se doublaient d’un art de la torture particulièrement élaboré, ont fait couler énormément d’encre, tant en ce qui concerne leur description – en particulier par les jésuites – que leur analyse contemporaine.
Outre la richesse (et donc, parfois, le caractère contradictoire) de la documentation, la compréhension de la guerre iroquoise se heurte à deux difficultés. La première est banale, et touche à l’ensemble des événements sociaux. Faut-il privilégier les facteurs proximaux ? Croire les acteurs sur parole, ou se fier à l’idée qu’ils se faisaient de leurs actes ? Rechercher des déterminations plus profondes, y compris en admettant que les intéressés pouvaient ne pas en avoir conscience ? Ces questions, inévitables, expliquent que des débats continuent de diviser les historiens sur des événements aussi bien connus que les deux guerres mondiales – sans même parler d’événements plus actuels.
La seconde difficulté est plus spécifique au cas iroquois. Le phénomène guerrier chez ce peuple, si saillant au XVIIe siècle où il se constitue en puissance régionale, brisant ses voisins les uns après les autres, apparaît au moins possiblement comme un phénomène post-contact. Qu’en était-il avant celui-ci ? Dans quelle mesure l’échelle, la nature et le mobile des opérations militaires iroquoises ont-il été affectés par la présence occidentale ?
Sans prétendre évidemment clore un débat (ni même prétendre être un spécialiste de cette question), je voudrais dans ce billet rassembler quelques éléments.
La première chose est de discerner qu’avant le contact comme après, il existait manifestement deux grands types d’opérations militaires qui se différenciaient sous bien des aspects. Le jésuite François-Joseph Lafitau, bon connaisseur de peuple chez qui il avait résidé plusieurs années et dont il avait appris la langue, au début du XVIIIe siècle.
La guerre peut-être regardée ou comme particulière quand elle se fait par de petits partis, dont il y a presque toujours quelqu’un en campagne ; ou comme générale quand ils marchent en corps d’armée et qu’elle se fait au nom de la nation. (p. 167)
La « petite guerre » se décide donc à un niveau élémentaire. Les chefs n’ont aucun pouvoir formel pour l'interdire. S’ils désapprouvent une expédition, ne serait-ce que parce qu’elle vise un allié actuel ou potentiel, tout au plus peuvent-ils agir de manière indirecte, par exemple en répandant de fausses nouvelles. Les effectifs engagés sont maigres : moins d’une dizaine d’hommes, éventuellement renforcés par quelques individus des villages qu’ils traversent. Ces expéditions :
(...) vont porter la guerre chez les peuples les plus reculés. Ils feront deux ou trois ans en chemin, et feront deux ou trois mille lieux, à aller et venir pour casser une tête, et enlever une chevelure. Cette petite guerre est un véritable assassinat et un brigandage qui n’a nulle apparence de justice, ni dans le motif qui l’a fait entreprendre, ni par rapport aux peuples à qui elle est faite ; ils ne sont seulement pas connus de ces nations éloignées, ou ne le sont que par les dommages qu’ils leur causent, lorsqu’ils vont les assommer ou les faire esclaves, presque jusqu’aux portes de leurs palissades. Les sauvages regardent cela néanmoins comme une belle action. (p. 169)
La maigreur du butin, qui se limite donc parfois à un unique scalp, constraste de manière saisissante avec l’incroyable investissement des combattants, qui accomplissent donc des voyages au très long cours. En réalité, si l’on tue à l’occasion de ce type d’action (ils « cassent la tête aux blessés et à ceux qui ne peuvent les suivre », p. 256), celles-ci ont aussi – et surtout ? – pour but de ramener quelques prisonniers. Lafitau écrit en effet que de tels actes sont « indispensables par une de leurs lois fondamentales » (p. 163) : il faut remplacer les morts, à l’initiative des « mères de cabanes », c’est-à-dire les femmes dirigeant les matrilignages. Si une partie des prisonniers est donc mise à mort dans d’abominables sévices, d’autres sont adoptés, manifestement après une période plus ou moins longue de mise en dépendance. Lafitau donne une description pleine de nuances :
La condition d’un esclave à qui l’on donne la vie [à qui on la laisse !, CD] (...) parmi les Iroquois et les Hurons, elle est aussi douce, à proportion que celle de ceux qu’on jette au feu est cruelle. Dès qu’il est entré dans la cabane où il est donné, et où l’on a résolu de le conserver, on détache ses liens (...) Peu de temps après on fait festin à tout le village pour lui donner le nom de la personne qu’il relève : les amis et les alliés du défunt font aussi festin en son nom pour lui faire honneur : et dès ce moment il entre dans tous ses droits. Si l’esclave est une fille donnée dans une cabane où il n’y ait point de personne du sexe en état de la soutenir, c’est une fortune pour cette cabane-là et pour elle. Toute l’espérance de la famille est fondée sur cette esclave, qui devient la maîtresse de cette famille, et des branches qui en dépendent. Si c’est un homme qui ressuscite un Ancien, un considérable, il devient considérable lui-même, et il a de l’autorité dans le village s’il sait soutenir par son mérite personnel le nom qu’il prend.
L’intégration semble donc totale : dès lors que le prisonnier est adopté, il devient en apparence un membre de la tribu de plein droit. Les lignes qui suivent tempèrent toutefois singulièrement cette appréciation :
À la vérité les esclaves, s’ils sont sages, doivent se souvenir de l’état où ils ont été et de la grâce qu’on leur a faite. Ils doivent se rendre agréables par leur complaisance, autrement leur fortune pourrait changer, même après plusieurs années d’adoption, surtout si les familles où ils sont entrés sont nombreuses et peuvent aisément se passer d’eux. Mais leurs maîtres, quoiqu’ils sentent bien leur supériorité, ne la leur font point sentir, ils s’appliquent au contraire à leur persuader qu’étant incorporés dans leurs familles, ils sont les maîtres comme s’ils étaient dans la leur propre, et qu’ils sont entièrement semblables à eux. Quelquefois même ils leur disent qu’il leur est libre de rester ou de retourner dans leur pays : ce parti serait néanmoins dangereux à prendre si on pouvait le pressentir, et leur coûterait infailliblement la vie, s’ils avaient le malheur d’être pris une seconde fois.
On peut donc s’interroger sur le statut exact de ces prisonniers qui ne sont frappés d’aucun empêchement ou même de dépréciation juridique formels, qui jouissent en apparence de tous les avantages de ce qu’on pourrait appeler de manière anachronique une citoyenneté de plein droit, et qui ne sembnlent pourtant qu’en sursis, toute déloyauté de leur part pouvant leur coûter la vie. Quelle que soit la réponse à cette question difficile, Lafitau salue la sagesse et l’efficacité de cette politique :
Une conduite si douce des Iroquois envers leurs esclaves est l’effet d’une excellente politique ; car ces esclaves ne voyant presque point de différence entre les Iroquois naturels et eux-mêmes, ne s’aperçoivent aussi presque point de leur servitude, et ne sont point tentés de s’enfuir. Les nations elles-mêmes à qui l’Iroquois fait la guerre ou qui font pressées d’ailleurs par des voisins inquiets, ne se sentant pas en état de résister aux uns et aux autres, écoutent plus volontiers les propositions que les Iroquois leur font faire de se donner à eux pour ne faire ensemble qu’un même peuple ; et c’est ainsi que ceux-ci obtiennent plus facilement les deux points qui leur sont les plus essentiels, qui sont de soutenir leurs familles chancelantes et de grossir leur nombre ; ce qui leur donne la supériorité qu’ils ont depuis si longtemps sur les autres nations. (p. 308-310)
 |
| Iroquois ramenant un prisonnier. P.-J.-M. Chaumonot, vers 1666 |
Pour en revenir aux salps, le fétichisme qui les entourait était manifestement suffisamment puissant pour qu’ils soient reconnus comme le strict équivalent de l’humain (vivant) auquel ils avaient été pris :
On distribue aussi en même temps les chevelures, lesquelles tiennent lieu d’un esclave et remplacent aussi une personne. Ceux qui reçoivent ces chevelures les conservent avec soin, les suspendent quelques temps aux portes de leurs cabanes. Elles s’en font un ornement dans les solennités publiques, surtout lorsqu’on chante la guerre, et enfin elles les suspendent de nouveau aux portes de leurs cabanes, où le temps achève de les consumer. (p. 271)
Si la norme est celle de l’équivalence - un prisonnier pour un tué - l’éminence de certains personnages, fussent-ils décédés de mort naturelle, justifiait qu’il faille plusieurs individus (ou plusieurs vies) pour les remplacer. Il existait toutefois une tension entre la volonté de faire honneur aux morts et les risques que celle-ci faisaient encourir à ceux qui étaient charger de ramener des prisonniers :
On brûle toujours deux ou trois esclaves lorsqu’ils sont donnés pour remplacer des personnes de grande considération, quand bien même ceux qu’on remplace seraient morts sur leur natte et de leur mort naturelle. On n’est point surpris que ceux à qui on les donne les jettent au feu, selon leur expression. Mais après cela il faut que les personnes intéressées se contentent ; car l’obligation de remplacer les morts, subsistant toujours dans les enfants par rapport à la cabane de leurs pères et de leurs tantes, jusqu’à ce qu’on ait donné la vie à une personne, qui représente celle qu’on veut ressusciter. Ceux qui ont cette obligation auraient droit de se plaindre qu’on les ménage peu, puisque pour faire un esclave ils sont obligés de courir les risques d’être faits esclaves eux-mêmes, d’être tués ou brûlés, de la même manière dont ils les brûlent chez eux. (p. 272)
Un des caractères les plus remarquables de ces actions était l’attention portée à l’absence de morts parmi les aggresseurs. Pour le résultat final, celle-ci comptait autant que la capture de prisonniers :
S’il n’y avait eu personne de tué ou de mort du côté des vainqueurs, comme il arrive souvent dans les petits partis, qui vont plutôt à la picorée qu’à la guerre, alors l’envoyé, au lieu d’un cri de mort, fait un cri de triomphe, etc. (p. 265)
On notera l’expression d’une justesse saisissante : ces groupes « vont plutôt à la picorée qu’à la guerre ». Ces actions, n’ont en effet pas pour but de soumettre l’adversaire, de l’obliger à accomplir notre volonté, comme l’écrivait Clausevitz. Il s’agit simplement d’effectuer sur lui un prélèvement – en quelque sorte, on est aussi loin de la guerre qu’une simple attaque de banque l’est d’une confiscation des établissements financiers décrétée à l’échelle nationale. Dans les termes de la classification que j’ai commencé à exposer précédemment, si l’acte est bien unilatéral, il n’est pas résolutif : il n’a pas pour objectif de ramener la paix (ou la concorde) aux conditions de celui qui en prend l’initiative. Autrement dit, il ne s’agit pas d’une petite guerre, puisqu’il ne s’agit pas d’une guerre du tout.
Je terminerai ce billet par un passage où Lafitau se livre à un exercice d’ethnologie inversée fort instructif. Après avoir rappelé l’étonnement qui saisit un Européen face à cette culture marquée par la facilité avec laquelle un différend bénin, voire un simple malentendu, entre membre de deux tribus, devient une question d’honneur justifiant le recours aux armes, il poursuit :
Ils ne sont pas moins étonnés de cette indifférence que les Européens ont pour ceux de leur nation, du peu de cas qu’ils font de la mort de leurs compatriotes tués par leurs ennemis. Chez eux un homme seul tué par une nation différente de la leur commet les deux nations et cause une guerre. Parmi les Européens, la mort de plusieurs des leurs ne paraît intéresser personne. Ils ont vu sur cela des exemples d’une insensibilité qui les a surpris, et qui leur a inspiré pour nous de l’indignation et du mépris. Ils se sont offerts eux-mêmes à venger les Français, qui ne paraissaient pas touchés du massacre de leurs frères et de leurs concitoyens assassinés par d’autres nations sauvages. On n’a rien eu à répondre à leurs propositions, et ils en ont été scandalisés. (p. 291)
À suivre, avec la « grande » guerre...

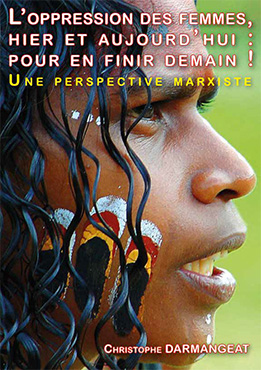

Merci et vivement la suite!
RépondreSupprimerCe ne sera pas pour tout de suite, entre-temps il y a d'autres billets dans la file... ;-)
SupprimerCe n'est pas grave, j'attendrai. Et je ne doute pas que ces billets seront aussi intéressants que bien d'autres :)
RépondreSupprimerVil flatteur.
SupprimerMaintenant il ne va pas falloir me décevoir... héhé
RépondreSupprimerSur la gravure « Iroquois ramenant un prisonnier », le personnage de droite porte bien une sorte de fusil ?
RépondreSupprimerTout à fait. Ces descriptions picturales sont postérieures au contact avec les Occidentaux, et les Iroquois possèdent donc dorénavant des armes à feu.
SupprimerOui probablement une arme française à silex de la fin du XVIIIème, comme celle-ci: https://monsantic.com/fr/lots/9/0408-arme-fusil-francais-a-silex-modele-1777-corrige-an-ix
SupprimerIntéressant. Cela éclaire un peu la discussion d'il y a quelques semaines sur la comparaison des vertus de l'arc et des armes à feu pré-modernes, non ?
SupprimerCeci alors même que les Iroquois ne disposaient pas du système technique permettant d'être autonomes dans l'utilisation des armes à feu (j'imagine qu'ils ne fabriquaient pas leur poudre et leurs munitions eux-mêmes ?).
SupprimerVous avez raison, Antoine : cela éclaire un peu. Quoiqu'il y ait d'autres raisons possibles que la simple efficacité, pour préférer le fusil à l'arc. Par exemple, le prestige qui s'attache à une arme spectaculaire et importée, probablement coûteuse.
SupprimerJe disais juste que le grand arc anglais utilisé en terrain découvert et par des grandes formations d'archers tirant de façon coordonnée (ce qui n'est pas du tout comparable à ce qui se passait chez les Iroquois) était resté très longtemps le plus efficace. Et que cette efficacité résidait moins dans l'objet lui-même (admirable par ailleurs) que dans l'organisation militaire, et plus largement sociale, qui avait permis l'exploitation maximale de cet objet.
M. G.
Et peut-être un Charleville 1777... mais je ne suis pas expert
RépondreSupprimer